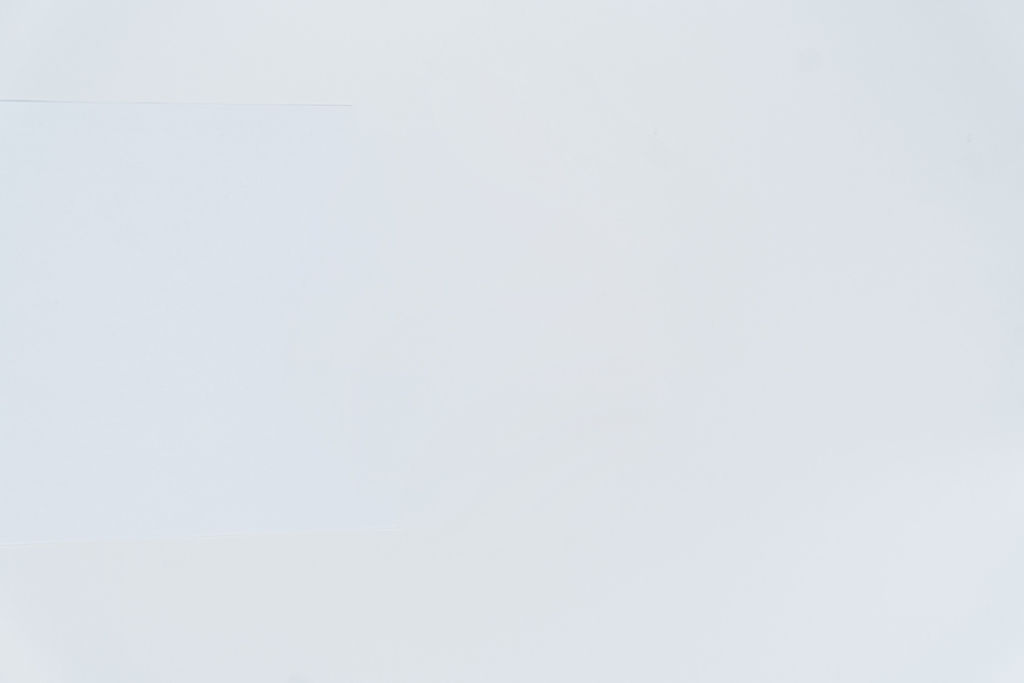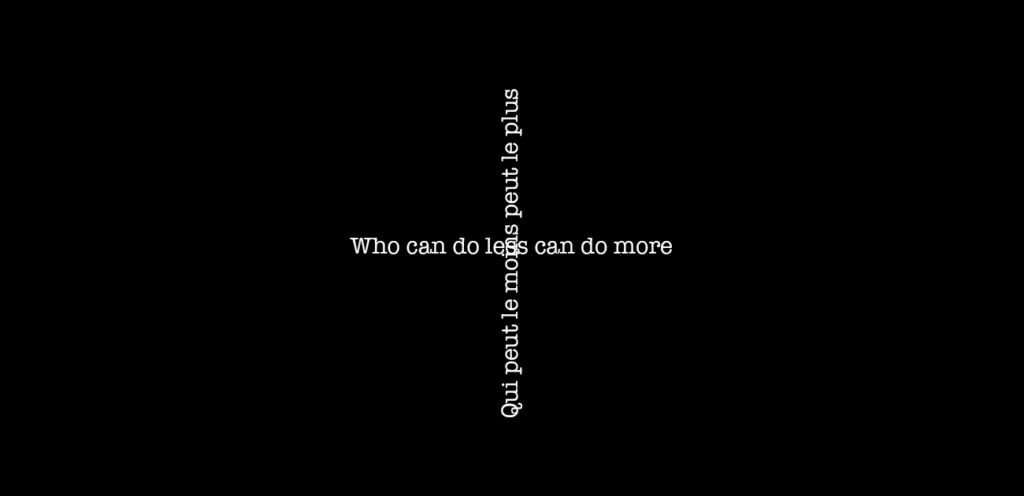Avec cet entretien entre la critique d’art Camille Paulhan et l’artiste Florence Jung, Switch (on Paper) poursuit ses investigations sur la disparition ou l’effacement de l’art. À l’exception près qu’ici, Florence Jung n’a pas exactement décidé de disparaître mais plutôt de ne jamais apparaître, préférant la rumeur, les photos volées et « la possibilité de n’avoir rien vu, rien entendu ».
Fin 2014, j’ai reçu un message d’une dénommée Florence Jung, qui souhaitait que j’écrive un texte pour son exposition personnelle programmée en février de l’année suivante au Centre d’art Circuit, à Lausanne. Son message s’achevait par des mots mystérieux : « Mes pièces ne se situant pas dans le domaine visuel, mon travail est uniquement documenté par des textes critiques, disponibles en pièce jointe ». Malgré cet avertissement, j’eus la faiblesse de taper machinalement ses prénom et nom, soigneusement mis entre guillemets, sur Google. Elle avait raison : le « domaine visuel », si cher à nombre d’artistes lui étant contemporains, n’était véritablement pas le sien. Google Images me proposait pour toute réponse quelques photographies, celles d’une infirmière puéricultrice messine, une traductrice indépendante de Reichshoffen (dans le Bas-Rhin), une consultante en microbiologie strasbourgeoise, et une assistante de direction colmarienne qui citait Confucius sur sa page LinkedIn. Mis à part le tropisme Grand Est, j’étais un peu perdue.
Depuis 2012, Florence Jung écrit des « scénarios », des scripts mettant en scène des situations qui s’immiscent dans le réel. Sans le savoir, j’avais déjà été témoin d’œuvres de Florence Jung, que je n’avais pas vues, que j’avais ignorées ou que j’avais prises pour tout autre chose. Par la suite, j’ai pu faire l’expérience, pour mon plus grand plaisir, de plusieurs autres scénarios de l’artiste, également ignorés par le public ou qui provoquèrent une méprise totale à leur sujet. Car Florence Jung est une infiltrée, une rumeur, peut-être même une hallucination. C’est la raison pour laquelle j’ai été surprise qu’elle accepte l’entretien publié ici, qui s’est déroulé à Paris en juin 2021 – peut-être.
Camille Paulhan : Florence, je voulais commencer l’entretien en te faisant part d’une étrangeté que j’ai pu rencontrer plusieurs fois : il se trouve qu’il existe des personnes qui pensent que tu n’existes pas, et qui me le soutiennent mordicus. Or je suis à peu près sûre qu’en ce moment je suis bien en train de te parler. Il n’y a en effet aucune photographie de toi sur le web, et ton site Internet brille par son austérité visuelle, puisqu’il n’y a pas d’images de tes œuvres. Comment as-tu souhaité non pas disparaître, mais ne pas apparaître ?
Florence Jung : Parler d’absence d’image, c’est encore parler d’image. Il n’y a pas vraiment de raison pour que j’apparaisse, c’est tout.
CP : Mais comment fais-tu pour échapper à ce système de visibilité ? Quand il y a une exposition, il y a souvent des photographies collectives, des diffusions sur les réseaux sociaux, etc.
FJ : Je n’utilise pas les réseaux sociaux. Je n’y pense jamais.
CP : Mais justement, j’ai l’impression que depuis une dizaine d’années, on réclame beaucoup des artistes. On attend d’eux qu’ils et elles posent à côté de leurs œuvres, postent sur Instagram les photographies de leurs enfants, montrent l’intérieur de leur atelier, une visibilité qui somme toute pourrait être celle de stars.
FJ : Il me semble que le pouvoir des artistes est d’inventer leurs propres règles. On associe souvent l’être à l’apparaître et la valeur à la visibilité. Il existe pourtant de multiples manières de travailler, de se présenter, de documenter. Personne n’est tenu de se subordonner à l’économie de l’attention ni d’entrer dans une logique d’auto-promotion…
CP : Lorsque tu archives tes œuvres, tu les compiles dans un dossier numérique qui s’amplifie au cours des années ; tu me l’as envoyé pour préparer cet entretien, il s’agit d’un pdf assez simple, avec une sélection de tes scénarios, des textes factuels sans aucune image. Chaque œuvre a pour titre Jung, suivi d’un numéro qui correspond à sa place dans ta chronologie. La première page de ce document indique : « Do not distribute » : comment envisages-tu cette absence de preuve, de documentation ?
FJ : J’essaye d’éviter l’autorité du texte qui affirme et de l’image qui justifie. Refuser d’auto-documenter mes pièces permet de faire émerger des formes résiduelles qui échappent aux standards actuels de la circulation des œuvres d’art. Alors – plutôt que de produire d’impeccables images full HD retouchées et hallucinantes de neutralité –, je laisse aller les rumeurs et les photos volées, ainsi que la possibilité de n’avoir rien vu, rien entendu.
CP : Mais par rapport à une certaine histoire de la documentation de la performance ? Il y a toute une généalogie d’artistes des années 1960-70, que la critique d’art Sophie Lapalu a bien étudiée, qui a parfois cherché une documentation minimale, sans photographie, sans preuve par l’image.
FJ : Il me semble qu’au contraire les artistes de cette génération – à part Lee Lozano, Ian Wilson, et quelques autres – ont plutôt cherché à documenter leurs œuvres à tout prix. J’imagine que c’était à la fois une volonté commerciale et un désir de réifier les idées pour les conserver. C’était une autre époque, d’autres questions. Aujourd’hui, notre paysage visuel est saturé par un nombre infini d’images toutes similaires. Des photos de repas, de séances de sport, de nouveaux achats, de couchers de soleil, de publicités amusantes, d’animaux mignons et d’inconnu·es à leur insu. Nous sommes des milliards à auto-documenter nos existences en permanence. Pourtant tout le monde sait que ce que montrent ces images ne compte pas. Ce qui compte c’est qu’elles existent : « Pics or it didn’t happen ». Il s’agit non seulement de fournir des preuves, mais de faire en sorte que ces preuves soient visibles, vues, validées. C’est une lutte sans cesse renouvelée contre le solipsisme. Et c’est cela qui m’intéresse le plus dans le monde, ce doute qui nous hante sur l’existence de ce qui nous entoure. Paradoxalement, l’ère des médias sociaux – et l’obsession de tout documenter qui en résulte – n’a fait qu’intensifier ce doute, jusqu’à le rendre pathologique pour la plupart des êtres humains possédant un smartphone. Ce que je fais se soustrait à l’impératif de visibilité. Tous mes scénarios décrivent des situations qui ont eu lieu mais pour lesquelles il n’existe pas de preuve.
CP : Mais tu réalises aussi des objets au statut ambigu, presque des indices d’une enquête. Par exemple pour Jung62, au centre d’art Forde (Genève), les visiteur·ses recevaient, en échange de la copie de leur carte d’identité, de leurs empreintes digitales et d’un scan 3D de leur visage, une clé USB avec ces mêmes informations appartenant à une autre personne. Pour Jung63, à Tarsia (Naples), le scénario invitait les personnes à se rendre dans un café pour demander « Giuseppe », sans savoir que ce dernier venait de quitter définitivement la ville. Ils se voyaient alors remettre un mot leur indiquant : « This note is for you, because we never met and, most likely, never will. Giuseppe » [Cette note est pour vous car nous ne nous sommes jamais rencon-tré.e.s et ne nous rencontrerons probablement jamais. Giuseppe]. Pour Jung64, à la Rijksakademie (Amsterdam), chaque personne retrouvait dans ses affaires quelque chose qu’elle ne se rappelait pas avoir emporté. Pour Jung65, au Helmhaus (Zurich), enfin, un gardien nous glissait discrètement un papier avec un numéro de téléphone à appeler immédiatement…
FJ : Ces objets n’ont pas d’importance en soi, ils permettent seulement d’activer un autre type d’attention. Anxieuse, passive. Un mélange d’hyper vigilance et de la sensation, malgré tout, de manquer quelque chose.
CP : Mais quel est ton lien aux images ?
FJ : Aucun en particulier, je crois. Depuis qu’on peut créer des images en moins de temps qu’il n’en faut pour les regarder, elles ont perdu leur fonction de représentation. Elles sont devenues la réalité. Sans images, les choses deviennent plus incertaines, un peu glissantes. On entre dans un autre registre, celui du mythe, de l’hallucination ou du trip paranoïaque.
CP : Comment envisages-tu la dimension politique qui consiste à s’opposer à la sur-visibilité, à la belle image, et donc au spectaculaire ?
FJ : Trop d’images annule l’image. L’absence d’image crée des images. Tout est politique. Je n’oppose pas l’un à l’autre, je cherche ce qui se cache derrière ce qui est immédiat, évident, expansif, efficace.
CP : Comment fais-tu face aux injonctions institutionnelles liées aux textes de médiation ?
FJ : Je les évite, sinon je les infiltre.
CP : Que se passe-t-il si personne ne décèle tes œuvres ? Je suppose que cela a peu d’importance pour toi, tant que le récit est possible.
FJ : On dit qu’il faut croire pour croire. Peut-être faut-il aussi voir pour voir. Nous nous situons dans une période de l’histoire où les évènements s’enchaînent sans discontinuer et pourtant « nous nous ennuyons tous à crever » comme l’affirme l’écrivain J.G. Ballard lorsqu’il ouvre le siècle avec Millenium People. C’est exactement là où je place mon travail, à l’endroit où notre rôle de témoin devient auto-réflexif.
CP : Est-ce que le résultat peut être complètement différent de ce que tu imaginais, voire tout à fait raté ? Je me souviens que la première fois que j’ai vu une œuvre de toi, c’était au salon de Montrouge en 2013. Tu avais loué ton espace d’exposition à une guinguette végan-locavore, pour financer un « Prix Jung », destiné à être redistribué intégralement et équitablement à tous les artistes de l’exposition. Et moi, n’ayant pas lu le cartel – car je n’avais même pas vu qu’il s’agissait d’une œuvre – je suis passée devant en soupirant, et en glissant à la personne qui m’accompagnait : « Typique du salon de Montrouge… »
FJ : La physique a prouvé qu’une expérience n’est pas la même selon qu’on la regarde ou non. C’est fascinant, n’est-ce pas ?
CP : Cet été, tu as participé à la biennale de Môtiers en Suisse (20 juin-20 septembre 2021), et tu as souhaité inviter « une étrangère » afin qu’elle vive dans le village pendant la durée de l’exposition – trois mois, soit la durée légale pendant laquelle une personne non-suisse peut rester dans le pays sans visa. Quand tu réalises ce genre de projets, comment abordes-tu l’histoire qui peut s’y rattacher, et que tu envisages comme une rumeur, susceptible de prendre ou ne pas du tout s’ancrer dans son territoire ?
FJ : Cette œuvre repose sur la présence d’une étrangère dans un petit village Suisse, dans ce cas, une jeune femme originaire d’Europe de l’Est, arrivée seule et sans connaître personne. Il est possible d’aller sonner chez elle. Si elle s’y trouve. Mais il est aussi possible de la rencontrer à la boulangerie, au café, dans la rue, à la gare ou pas du tout. La rumeur est contingente, je ne la recherche pas, je ne la réprime pas. Comme au cinéma, mon scénario définit ce qu’il se passe en théorie. Mais la réalité surgit nécessairement, puis se confond avec le scénario. C’est une pièce impermanente, fluide, instable dans l‘expérience qu’on peut en faire. C’est une pièce qui s’hybride avec la vie et sur laquelle je n’ai aucun contrôle.
CP : Si je te suis bien, tu voudrais que tes œuvres ne soient pas qu’une expérience esthétique, mais une émotion réelle et durable ?
FJ : Le mot esthétique et le mot émotion sont trop chargés. Disons, une expérience réelle. Réelle, avec la part de fiction que cela implique.
CP : Ton œuvre, bien que très immatérielle, peut finalement être assez coûteuse pour l’institution, même si elle n’est pas spectaculaire. Comment fais-tu par rapport aux contraintes spécifiques des lieux où tu exposes ?
FJ : Je n’ai qu’une règle, celle de ne pas payer pour travailler. Je n’ai ni matériel ni atelier. Le confort engourdit.
CP : Tu me reçois chez toi, et je vois qu’il n’y a pas de table, pas de chaise : où travailles-tu ?
FJ : Je travaille dans les trains, les cafés, les bibliothèques… Pour voir les gens autour de moi, pour voir la journée défiler. Cela me presse. Je n’ai jamais eu le désir d’avoir des employé·e·s, des assistant.e·s, des stagiaires. C’est une question éthique autant que pratique. Offrir des conditions de travail décentes nécessiterait de transformer mon travail. Et l’exploitation n’est pas une option. Je suis donc généralement seule, chroniquement mal installée et structurellement libre.
CP : Quand tu parles de conditions de travail décentes, je pense au scénario Jung78, pour lequel tu demandes à ce que la personne la moins payée d’une organisation donnée perçoive le même salaire que la personne la mieux payée.
FJ : Cette pièce est un cheval de Troie dissimulé dans un autre cheval de Troie. On croit y voir une œuvre charitable. Puis on croit voir une œuvre charitable dissimulant une proposition égalitaire. Mais c’est une œuvre faussement charitable qui dissimule une proposition faussement égalitaire. En effet, il ne s’agit pas de suggérer une solution de type marxiste, qui supprimerait les inégalités en donnant la même chose à tous. Non, c’est une pièce qui rejoue un système fondamentalement injuste car, derrière la personne la moins payée, il existera toujours la seconde personne la moins payée et peut-être pas moins méritante. Nous savons qu’à niveau d’études et d’expérience égaux, la responsabilité sociale est moins rémunératrice que la responsabilité financière. Nous savons que le « risque humain » est moins valorisé que le risque financier. Il s’agit de repenser les critères communément admis pour déterminer la valeur du travail, d’ouvrir un débat entre ce qui justifie un (très) haut salaire par rapport à un (très) bas salaire en créant une symétrie ponctuelle. Cela me fait penser à cette interview de Warren Buffet sur CNN où il déclare qu’il y a une guerre entre les pauvres et les riches, et que ces derniers sont en train de la gagner. Ce qu’il n’a pas dit, c’est que l’une des tactiques employées dans cette « guerre » est de dresser les pauvres les uns contre les autres. Ce qui est aussi un cheval de Troie dissimulé dans un autre cheval de Troie…
CP : Est-ce que ce Jung a bien été réalisé ?
FJ : Tous mes scénarios ont été réalisés. Sinon, je les appellerais des idées. Cette œuvre a d’abord été pensée pour une école. Elle a ensuite été activée dans une institution culturelle. Idéalement, j’aimerais qu’elle soit rejouée dans une entreprise.
CP : Je souhaitais que l’on revienne également sur une personne bien réelle, et tout aussi mystérieuse, sur laquelle tu travailles depuis quelques années : Luca Bruelhart, ou Lukas Brulhard. Peux-tu nous parler un peu de ce projet dont, à bien des égards, on pourrait imaginer qu’il s’agit d’une fiction ?
FJ : Luca Bruelhart (ou Lukas Brulhard) est un inconnu que j’ai rencontré dans une fête chez des amis il y a huit ou neuf ans. C’était une grande fête. Personne ne le connaissait. Le lendemain matin, il était encore là. Les jours suivants aussi. Finalement, il n’est jamais parti. À cette période, je poursuivais des recherches sur la discrétion comme mode de dissidence. J’ai reconnu en Luca, ou Lukas, l’objet même de mon travail. Du jour au lendemain, j’ai tout arrêté pour l’observer. Je ne lui connais ni centre d’intérêt, ni travail, ni relation. À vrai dire, je ne sais toujours pas son vrai nom ni s’il possède une clé de cette maison. De manière presque ordinaire, absolument non-héroïque, il incarne la contestation ultime de nos modes de vie. Complètement intégré et complètement désintégré.
CP : Mais comment l’as-tu fait entrer dans ton travail ?
FJ : Au début, c’était circonstanciel. Puisqu’il ne l’utilisait pas, j’ai commencé à emprunter son identité pour signer des pétitions, peut-être quelques textes. Et puis j’ai créé New Office, une société écran qui fonctionnait sur le modèle du parasite. New Office publiait quotidiennement des annonces examinant nos anxiétés contemporaines sur un ton très personnel (Si tu crains la médiocrité plus que la mort, appelle …, Si tu veux le pouvoir sans la responsabilité, appelle…, Si ton principal talent est d’en n’avoir rien à foutre, appelle…). Les données de ceux qui y répondaient étaient collectées, puis vendues. Un cauchemar algorithmique créé sur le modèle des applications que l’on connait. Mon hypothèse était que l’archétype du psychopathe entrepreneur contemporain n’est plus le trader décrit par Bret Easton Ellis dans American Psycho, mais le CEO à succès de la Silicon Valley. C’est comme cela que j’ai commencé à lire tout ce que je trouvais sur Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook… Finalement, je suis parvenue à dresser un profil psychologique type en isolant leurs caractéristiques communes : une frugalité revendiquée, un esprit disrupteur, une forme d’idéalisme anarchique, une certaine culture du secret… Des choses que j’avais paradoxalement déjà identifiées chez Luca Bruelhart, ou Lukas Brulhard. Ainsi, à son insu, je l’ai nommé gérant.
CP : Vois-tu le parasitisme comme une forme de disparition volontaire ? Je me souviens de ce fait divers de 2008, au Japon, où un homme qui constatait la disparition des aliments dans son réfrigérateur a fini par se rendre compte qu’une femme habitait clandestinement dans un placard de son logement.
FJ : Qu’il s’agisse du corps parasite ou du corps parasité, l’un des deux est forcément voué à disparaître, n’est-ce pas ? La question est de savoir où vont celles et ceux qui disparaissent. Sur les forums spécialisés, on parle beaucoup de l’Argentine, du Mexique, de la Russie, du Pakistan, même de la Nouvelle-Zélande. J’ai pris contact avec des gens qui vivent là-bas. Je leur ai demandé d’envoyer des lettres adressées à Luca Bruelhart, ou Lukas Brulhard. Des invitations.
CP : D’une certaine manière, tes œuvres ont quelque chose de cinématographique, ou qui pourrait relever du polar, de l’enquête ; la fiction n’est d’ailleurs pas uniquement extérieure à nous en tant que spectateur·rice·s, nous y sommes parfaitement intégré·e·s. Quels ont pu être tes modèles narratifs ?
FJ : Mes modèles narratifs sont partout. Le divertissement est passé du statut d’objet à celui d’environnement dans lequel nos vies se déroulent. Auparavant, c’était un produit que l’on consommait avant de retourner à la réalité. Il me semble que le divertissement – et le récit en général – fabriquent désormais la réalité. Il n’y a plus que des processus narratifs. L’art est un processus narratif, la politique est un processus narratif, la finance est un processus narratif, et nous sommes chacun·e la somme de nos propres processus narratifs, issue de toutes les histoires que l’on se raconte sur nous-même. Mais cela ne veut pas dire que rien n’existe, « un homme qui crie n’est pas un ours qui danse » disait Aimé Césaire. C’est plutôt qu’à force de tout présenter sous forme de récit, on obtient nécessairement des récits alternatifs. Évidemment, c’est dangereux. Très dangereux et très intéressant lorsque l’on cherche à examiner la manière dont un récit émerge. Et il semble que pour cela, il n’y a nul besoin d’image ni de preuve. Un doute suffit.