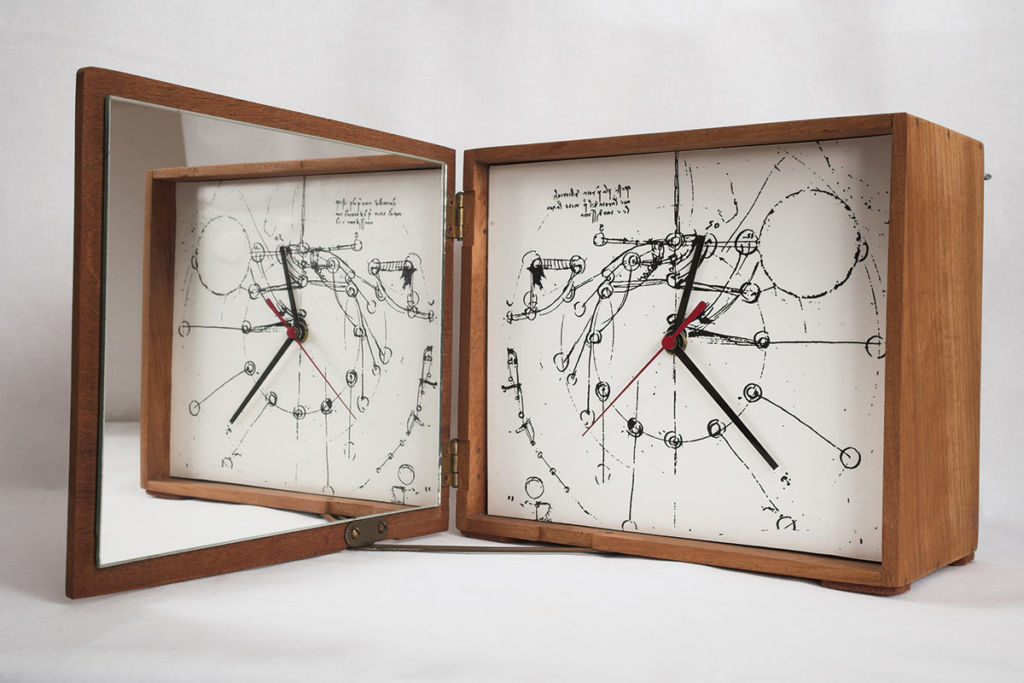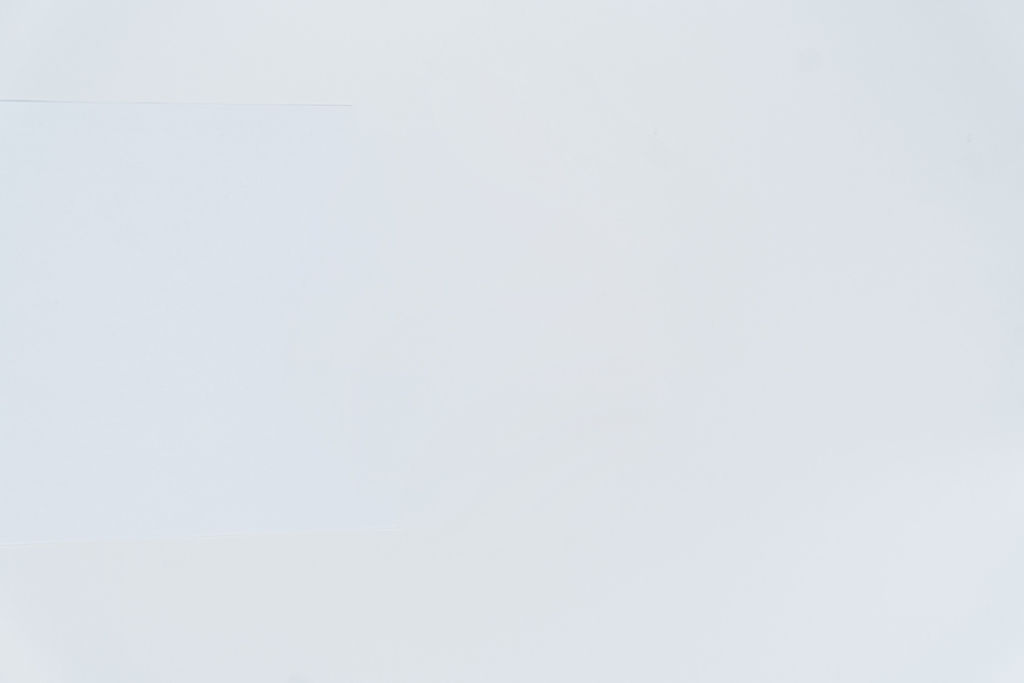Dissidents, rebelles, séditieux, l’histoire de l’art ne manque pas de ces artistes pour qui la vie et l’art sont indissociables et qui s’ingénient à ne rien exposer des deux. Fabrice Gallis fait sien ce sens de la disparition. Ses interventions, touchant le plus souvent le simple domaine domestique, récusent toute dimension spectaculaire, excluent toute propension à l’archivage documentaire. Pour lui, l’objet d’art est par nature transitoire, de faible amplitude et ne peut « exister que dans la mémoire ». Cet entretien en est la preuve. Pourtant, son souhait d’imposer dans l’échange le collectif somme toute auquel Fabrice Gallis appartient met en lumière son véritable statut, celui d’artiste-passeur.
L’histoire de l’art, de la littérature et, sans doute, de bien d’autres disciplines (est-ce, en cette occurrence, le mot adéquat ?) ne manque pas de figures dissidentes, rebelles ou séditieuses. Bien souvent, c’est au nom de l’insoumission que ces artistes ont laissé le leur à la postérité. Arthur Cravan, Jacques Vaché ou encore Jacques Baron surent dire non aux parcours établis, aux voies bien balisées et préférèrent opérer dans les bordures incertaines des champs bien peignés de la littérature. Au même moment, mais sans l’esprit de révolte qui animait ces derniers, le poète grec Constantin Cavalis, évoquant la vie, exhorte son contemporain : « Ne l’avilis pas / dans un trop grand commerce avec le monde / dans tout ce mouvement, tous ces discours / Ne l’avilis pas, en l’exposant. » Pour de tels artistes, la vie et l’art ne font qu’un et ne pas exposer la première revient à ne pas exposer le second. Mû par d’autres raisons, animé par des motivations différentes parce que l’époque n’est pas la même, Fabrice Gallis fait siennes de telles propositions. Ses interventions, touchant le plus souvent le simple domaine domestique, récusent toute donnée spectaculaire et excluent toute propension visant à leur archivage documentaire. Pour lui, l’objet d’art ne peut qu’être transitoire, de faible amplitude et, de fait, ne peut « exister que dans la mémoire ». Ses actions discrètes, économes, parfois clandestines, vont donc s’inscrire dans le courant de la vie, s’immiscer discrètement voire subrepticement dans le déroulé quotidien de l’existence. En ce sens, il est proche d’autres artistes qui ont choisi l’ombre plutôt que la pleine lumière, préféré créer des situations de portée volontairement limitée plutôt que proposer des actions vainement démonstratives. Fabrice Gallis partage ce point de vue avec l’artiste tchèque Jiří Kovanda dont les propositions, furtivement intrusives, peuvent être aisément assimilables à des gestes de la vie courante. Il n’est pas éloigné non plus d’autres artistes comme Jean-Baptiste Farkas ou Mladen Stilinovitch pour lesquels l’objet artistique est encombrant et qui optent respectivement pour des « services » et des « protocoles » ou pour des « gestes » – idées auxquelles forme est donnée dans des espaces qui ne sont pas forcément les lieux culturels habituels. Les expérimentations de Fabrice Gallis prennent cependant une tonalité différente en ce qu’elles privilégient l’échange, favorisent le partage et trouvent à pleinement s’accomplir dans le rapport de connivence avec l’autre. Le « coup du fil » que nous avons mené conjointement lors d’un colloque à l’université de Saint-Etienne et l’entretien présent que nous avons bâti ensemble en sont la preuve. Mais son souhait de donner la parole au collectif somme toute auquel il appartient met, plus encore, l’accent sur son statut d’artiste-passeur.
Maurice Fréchuret : Dans un entretien avec Sophie Lapalu, daté de 2017, vous faites état d’une conviction selon laquelle « un objet d’art ne pouvait être que transitoire » et que seule la mémoire peut lui redonner une certaine forme d’existence. De là découle votre pratique artistique qui exclut la fabrication d’objets – fussent-ils artistiques – propres à saturer plus encore notre environnement. Un tel principe reste-t-il chez vous encore en vigueur ? N’êtes-vous pas tenté parfois de l’infléchir et de vous adonner à la réalisation d’œuvres matériellement plus concrètes ?
Fabrice Gallis : Il est amusant que vous partiez de cet entretien1 car c’est précisément cette dimension transitoire que nous avions essayé de faire exister avec Sophie au sein de ce texte. Nous souhaitions faire disparaître l’entretien lui même en le diluant au fur et à mesure, de telle sorte que le lecteur ne sache plus, au bout d’un moment, quel pouvait en être le sujet, ou même l’auteur. C’était une manière de faire de cet échange une expérience concrète en l’élargissant au lecteur. Au bout du compte, le comité éditorial de la revue Tête à tête a choisi de mettre de côté cette dimension au nom de la cohérence éditoriale !

La dimension transitoire d’une proposition artistique ne devrait jamais être écartée, mais on fait souvent l’erreur de concevoir les objets adressés à un public comme immédiatement identifiables et inscrits dans un cadre clair. C’est étrange, car on sait que l’expérience – de l’art mais aussi l’expérience en tant que telle – est bien plus complexe qu’elle n’y paraît dans la relation qu’elle entretient à la mémoire. Tenter de contraindre un propos artistique dans un cadre normé (qu’il s’agisse d’un entretien, d’une exposition, d’un catalogue ou d’un prix) n’a pour résultat que d’affaiblir la dimension artistique au profit d’un gain de rentabilité, d’efficacité ou de visibilité, autrement dit, un écrasement de l’art dont la faiblesse est pour moi la qualité principale. Augmenter l’efficacité revient à clore, à empêcher la possible reconstruction de la forme par la mémoire du public.
En matière d’art, toutes les activités, même périphériques, ne peuvent faire l’économie de remettre leurs structures en question afin de cultiver cette fragilité de l’expérience, un peu à la manière de la flamme entretenue par le personnage principal dans l’avant-dernière scène de Nostalghia d’Andreï Tarkovsky.
Un entretien comme celui-ci, par exemple, répond souvent à un besoin de validation, en fournissant un moment de légitimité. Si le jeu de la légitimité est pleinement accompli, la parole de l’artiste et celle du critique ou de l’historien se renforcent et se soutiennent mutuellement pour faire histoire. C’est peut-être cela qui est à fuir, qu’il faut rendre impermanent.
Pour ce faire, j’essaie de transformer chaque situation de travail en zone d’expérimentation en devenir, de produire du flou là où la clarté serait attendue. Ainsi toute production d’un quelconque objet bien défini s’effondre au profit d’un dispositif à explorer. Sandino Scheidegger2 écrit en réponse à votre première question que « la mémoire ne peut faire appel qu’au mot « art » dans l’expression « objet d’art », l’objet lui-même vit sa propre vie – et ne se soucie tout simplement pas si nous, les humains, l’appelons « art » ou pas. Ce que nous nommons art ou non, est un énoncé qui prend corps au sein d’un récit, mais les histoires disparaissent toujours avec la dernière personne qui s’en souvient. Bien sûr, même si une histoire peut être écrite et maintenue en vie artificiellement, elle ne sera qu’une histoire perdue dans l’océan des autres histoires. »3
MF : Réfuter tout cadre normé (exposition, catalogue…) pour ne pas affaiblir la dimension artistique d’une proposition n’est ce pas encourir le risque de protéger cette dernière de toute souillure et donc de la confiner dans un état de totale (mais illusoire) pureté ?
FG : Le geste de réfuter implique de saisir à bras le corps une notion, un concept. Mais au lieu de remettre ce que l’on combat au centre, il serait peut-être plus judicieux de s’en détourner, de n’y porter aucune attention, ou plutôt d’embrasser un radiateur.
Une fois j’ai embrassé un radiateur.
Je l’ai mis à hauteur de ma poitrine et j’ai fermé les yeux. je l’ai fait comme une blague, le geste était vraiment très drôle. Cette blague a eu beaucoup de succès, c’était une blague conceptuelle et elle avait été déclenchée par un jeu de mots entre un objet artistique et une notion déterminée du désir. Mais je ne me souviens plus quel était le concept qui avait déclenché la blague. Mais il y restait la transition avec l’objet, à moins que l’objet n’ait été la proposition conceptuelle faite juste avant. Un sujet peut être un objet, un sujet de conversation, quelque chose de l’ordre du répété.
En bifurquant vers les marges, il est possible d’investir toute énergie d’invention dans des propositions qui ne seraient pas critiques mais plutôt à côté, là où la poésie travaille et produit un autre type de sens.
La critique institutionnelle – bien qu’elle ait produit des propositions passionnantes – n’est jamais parvenue à faire glisser le monde de l’art marchand hors de ses gonds. Un autre monde de l’art est possible, dans lequel les régimes de valeur sont redistribués, où l’autorité est diffuse et où l’artiste retrouve une position de simple citoyen⋅ne. La protection dont il⋅elle bénéficiait jusqu’alors se volatilisant, au lieu de le.la fragiliser, lui donne des ailes. Ce mouvement relativise les cadres normés jadis incontournables pour proposer des formats où la clarté s’efface au profit d’un nuage d’intuitions, de blagues, d’énoncés dynamiques dont la première qualité est de produire du lien au sein de la communauté des artistes mais aussi entre les artistes et un public non déterminé a priori.
MF : Votre détermination à brouiller les pistes, à produire du flou, à ne pas répondre aux injonctions du milieu artistique qui exige de la visibilité et de la clarté, à renoncer in fine à prendre place dans l’histoire de l’art, s’accorde-t-elle avec le projet, porté depuis longtemps par les courants libertaires et plus particulièrement par les situationnistes, de dépassement de l’art au profit de la vie ?
FG : Même si avec le recul de l’histoire les propositions des situationnistes semblent, après-coup, cohérentes, je ne sais pas si au moment de leur activité tout était aussi clair !
L’idée que l’art est avant tout un espace de partage, d’échange, de pensée collective s’impose dans de nombreuses initiatives portées par les acteurs de l’art au sein de certaines institutions mais surtout en dehors.
Mais comme l’art ne peut se satisfaire de produire de nouvelles institutions, il est nécessaire d’inventer des modes de dérive collective, au risque de perdre le sens.
Cet entretien est d’ailleurs devenu un cadre de travail où le je de l’artiste interrogé tente de devenir un nous incertain.
Je vous apprends ici que j’ai partagé les premières questions de cet entretien sur une interface d’écriture collective, un framapad4, au sein duquel j’ai invité des artistes ou des collectifs dont les pratiques me semblaient résonner avec les questions que vous posez.
Je n’ai par exemple jamais embrassé un radiateur ! C’est Liv Schulman qui a inséré cette proposition il y a quelques jours et qui ajoute d’ailleurs :
« La création de ce pad permet de créer des personnages éphémères mais empathiques avec les questions qui survolent le pad, inconsciemment. Je ne formule aucune proposition. Aucune règle non plus. Juste de la poésie, mal faite mais sûrement capable de toucher de l’argent. Pas de l’argent de la poésie, juste la poésie elle-même capable de produire de l’argent avec son travail. Elle travaille comme les dynamiques travaillent. »
Ce dispositif part de l’hypothèse qu’un artiste ne travaille jamais seul. La figure individuelle de l’artiste découle de la nécessité souvent marchande d’attribuer un auteur à une œuvre là où parfois des dizaines de personnes ont opéré à différents plans.5
Si on veut déjouer les systèmes qui isolent les artistes les uns des autres, on ne peut pas attendre qu’une microhistoire vienne retisser les multiples interactions après coup. Nous devons revendiquer les pratiques sous-jacentes, invisibles, floues ou laissées pour compte qui nourrissent un monde de l’art prêt à les vampiriser au profit de la scène artistique, lieu exclusif de légitimité.
MF : J’ai consulté le framapad que vous avez ouvert et lu les propositions des uns et des autres. Ce qui frappe avant tout est le foisonnement des interventions et, comme conséquence normale, une certaine dispersion des propos qui fait la richesse du dispositif mais qui en signale aussi les limites (ce que vous reconnaissez quand vous parlez de perte de sens). Est-ce le lot à payer quand, comme vous le dites, l’art est avant tout un espace de partage, d’échange, de pensée collective ?
FG : Je n’ai pas le sentiment que cette perte de sens constitue véritablement une limite. Elle peut effectivement freiner les échanges, compliquer les choses, mais j’ai plutôt l’impression que la clarté, l’univocité, sous des prétextes d’optimisation de la communication, imposent depuis trop longtemps une limitation. Ne peut-on pas considérer que cet entretien, dans sa forme classique, en s’adressant à un artiste, un homme, blanc, éduqué, laissant peut-être de côté un ensemble d’autres paroles tout aussi – voire plus – pertinentes, limitait leur accès à la publication ? Je ne crois pas que la complexité qui émerge ici soit générée par le jeu que j’ai lancé, mais qu’elle existe déjà autour de nous, je ne fais que tenter de la rendre visible.
Si on veut parler de transition, qui sont les personnes les plus à même de témoigner, sinon les personnes qui opèrent une transition dans leur identité ou leur appartenance, qu’elle soit artistique, de genre ou sociale ?

En art, il est toujours plus intéressant de parler avec que sur. Il serait ici aussi vain de gloser sur la transition que sur la disparition, alors que nous avons la possibilité de mettre en pratique d’une manière sensible ces principes.
Imaginons une sorte d’idéal où la figure individuelle de l’artiste aurait disparu au profit de pratiques dissoutes et quotidiennes intégrées par tous⋅tes, géni⋅e⋅s sans talent, tranquillement assis sans rien faire. Imaginons la possibilité qu’il n’y ait plus de distinction entre artiste et non artiste. Cette dénomination n’existerait pas au profit d’une capacité de chacun⋅e à œuvrer socialement (une idée proche de Joseph Beuys, pour qui chaque homme est un artiste, mais sans n’avoir plus besoin de parler d' »artiste ». Il faudrait aussi ajouter les femmes, trans, queer et intersexe). Or cette disparition ne peut s’opérer que de manière collective.
J’ai lu il y a quelque temps le roman terrible – la comparaison n’est peut-être pas la bienvenue – d’Olivier Guez, La disparition de Josef Mengele. L’auteur raconte comment « l’ange de la mort », le médecin d’Auschwitz qui a opéré des expérimentations monstrueuses au sein du camp, a tenté après la guerre de poursuivre sa vie en toute impunité en Amérique du sud, aux côtés de nombreux exilés du Troisième Reich. Il se trouve que l’Argentine sous Perón est bienveillante envers les nazis. Il apparaît que sa disparition nécessite un réseau complexe de complices pour l’aider à fuir, puis pour l’entretenir une fois sur place, voire pour lui permettre de continuer à exercer.
Disparaître est une entreprise collective.
J’ai lu un article il n’y a pas longtemps qui parlait de la façon avec laquelle Kanye West avait essayé de révolutionner le format album avec « The Life of Pablo » en ne sortant pas de version de son album en physique et en tirant parti des possibilités du streaming. L’album, la tracklist, la production des chansons ont été modifiés au fil des mois, procédés permis par le système de diffusion dans un réseau d’ordinateurs permettant des « mises à jour » beaucoup plus simples que dans le cas de la diffusion d’objets physiques. Une phrase de l’article est très curieuse et éloquente : « Dans le cas contraire, où un album n’aurait donc pas de fin et serait constamment changé, le processus créatif deviendrait alors le produit : on consommerait des modifications plus qu’une œuvre. » Il est intéressant de noter dans le cas de ce travail qu’il y a une sorte de tentative de « révolutionner » un format en ne changeant rien à la relation hiérarchique actif/passif, émission/réception entre l’artiste et le spectateur. Kanye West en ne renonçant pas à être l’auteur génial identifié d’une œuvre ne peut quelque part qu’agir de façon très superficielle dans la forme qu’il produit. Il tire parti de ce que les réseaux informatiques permettent en termes de plastique d’objets mais rien ou très peu à la relation de « consommation »6.
Des digressions sur la disparition ou sur la faculté de Kanye West à révolutionner la production musicale donnent à la fois la parole à d’autres mais aussi réalisent ici et maintenant une dilution du contenu qui met – selon moi – physiquement en jeu une disparition – du sens – pour le lecteur.
« La théorie Freak ne devrait pas (seulement) s’occuper de l’histoire « des freaks », mais devrait elle-même « être freaky » – agir et analyser de façon freak. Être freaky, à cet égard, nécessiterait de changer les statuts du savoir et de la négociation. »7
Ce que Renate Lorenz pointe à propos du travail de N.O. Body nous rappelle que l’art n’est pas exempt de relations de domination et que pour accueillir des pratiques en marge, il faudrait se laisser contaminer par le virus freak, le virus de la faiblesse, et que pour envisager un rapport à l’art qui soit plus collectif, il faudrait peut-être s’affaiblir encore un peu plus.
Pour poursuivre cet entretien et prolonger l’hypothèse d’un travail en commun et en faiblesse, je vous propose – si vous l’acceptez – que la prochaine question puisse être envoyée directement aux participants du framapad, en mettant à profit le temps de confinement qui se joue à l’heure où nous écrivons ces lignes, pour tenter une réponse chorale.
MF : C’est bien volontiers que j’accède à votre demande d’ouvrir cet entretien aux participants du framapad avec cette nouvelle question directement inspirée du projet de « création permanente » mis en place par Robert Filliou. Est-ce que la proposition de ce dernier, ainsi résumée : « Ne désire rien, ne décide rien, ne choisis rien, sois conscient de toi-même, reste éveillé, calmement assis et ne fais rien. » peut encore définir votre manière de penser et de pratiquer l’art ?
Anna Coulet : Je ne peux pas dire que cette proposition s’adapte à ma façon de pratiquer l’art. Le temps est à l’action, il est difficile aujourd’hui de rester immobile face à tous les changements qui s’opèrent autour de nous. L’artiste semble avoir les outils pour évoluer dans ce temps, avec comme outil principal, l’art, dont l’intérêt premier est de participer aux rêves collectifs. Je ne pense pas qu’il ait vocation à trouver les solutions concrètes à tous nos problèmes. Toute son importance est dans son pouvoir de narration, et ainsi la place qu’elle prend dans la mémoire de son public.

Walter Benjamin regrette le temps du conteur. « Ainsi se perd le don de prêter l’oreille, et de ceux qui prêtent l’oreille, la communauté disparaît. On ne raconte jamais d’histoires que pour qu’elles soient répétées, et l’on cesse de narrer dès que les récits ne se conservent plus. S’ils ne se conservent plus, c’est qu’on a cessé, en les écoutant, de filer et de tisser. » La narration laisse une place à l’imagination et l’interprétation que l’information (qui pourtant occupe la plus grosse partie de notre attention), n’a pas. Cette dernière doit être lavée de tout questionnement, de toute ambiguïté. Pour exister, elle doit paraître plausible aux yeux du plus grand nombre. Au contraire, l’art porte une attention particulière à laisser le public interpréter les événements. Il n’est pas nécessaire d’imposer les « à côté », l’important est de le mener vers ce qu’il ne peut imaginer, libre à lui après d’alimenter avec ses propres expériences et connaissances.
L’art raconte ces histoires, il tente de nourrir les rêves de son public, comme il l’a toujours fait. Mais il me semblerait faux de dire que cette proposition de Filliou est encore d’actualité, même l’artiste qui ne fait rien semble avoir réfléchi cette inactivité, il ne peut consciemment rester impassible face à l’époque dans laquelle il évolue. La forme de son art ne semble plus si importante en vue des rapports et des échanges qu’elle peut générer avec son public.
J’écris certainement avec toute la naïveté d’une étudiante, mais c’est avec cette vision que j’ai fait le choix de ne pas suivre le reste de ma famille, agricultrice, mais de m’engager avec leur vision du monde, leur rêve, dans cette voie. J’espère ne pas trop me tromper…
FG : Je partage beaucoup de choses avec Filliou et j’embrasse l’inactivité dans mes activités mais je ne peux pas rester si tranquille. Je préfère penser à la figure du bègue. Marc Shell dit que dans les approches cliniques, certains thérapeutes soutiennent que le bégaiement est induit par une conscience excessive du langage. Il se développe souvent chez des enfants qui sont trop corrigés par des parents qui accordent une valeur trop grande au discours correct. Le bégaiement apparaît donc comme un type de résistance à l’autorité parentale. Il pense que le bégaiement n’est pas un handicap physiologique, mais implique une grande conscience des relations de pouvoir du langage.
À cet égard, Karin Harraser ajoute que le bégaiement et le trébuchement, en tant qu’événements dans le temps, impliquent un moment de suspension dans lequel aucune décision consciente n’a encore été prise. Lorsque le mouvement est interrompu, le moment où tout est possible devient visible. Le bégaiement permet un processus de ramification, il ouvre un dédale d’actions possibles. C’est plus qu’une critique de ce qui est donné, c’est une force productive, un socle à l’émergence de possibilités non encore réalisées mais contenues dans ce qui est donné8.
Une pratique de l’interruption et de la répétition, pourrait être moins élégante que la proposition de Filliou mais peut-être aussi fortement déstabilisatrice en affaiblissant les systèmes rigides et les structures de pouvoir de l’intérieur.
Marc Buchy : C’est amusant j’ai souvent en tête Filliou mais je ne songe jamais à cette phrase, ou peut-être que je ne la connaissais tout simplement pas. Par contre je songe souvent à son « bien fait / mal fait / pas fait ».
Je m’intéresse à ce que fait Fabrice ici, à savoir se saisir/traiter du sujet transversal de sa pratique (disons, très très largement « disparaître » – et si j’ai bien compris de ce que je connais de sa pratique !) et de mettre en application l’une des stratégies qu’il a trouvées pour activer ce questionnement, ici donc, inviter d’autres participants, faire une forme ouverte, brouiller les sources etc… Il y a une mise en application « au premier degré » de son sujet. On ne peut donc pas dire qu’il ne « désire rien »… le geste général, un peu « chef d’orchestre » pour faire simple, reste même assez identifiable, non ? Mais dans l’ensemble ces réflexions sont des choses qui me plaisent et je pense que ça rejoint ce que je dis dans mon texte « infravisuel » où j’évoque la possibilité pour l’artiste de sortir du champ symbolique.
Je songe beaucoup à ce champ « non symbolique » et trouve ce type de propositions passionnantes et stimulantes tout en étant, in fine, problématiques car risquant de transformer l’art en « pure expérience » : je crois qu’il est aussi très dur de dire en faisant, d’émettre une idée sur ce qui est en train de se faire. Je pense qu’il peut-être intéressant parfois de se décoller de ce qui se passe pour pouvoir en émettre une idée réutilisable par d’autres, ou une critique ou une avancée, que sais-je… Mais peut-être est-ce là lié à ma propre obsession pour les questions de structures et de point-de-vue sur les choses. Je crois que je suis parfois obnubilé par l’idée de « voir le point de vue », et comprendre comment/de quoi ce point de vue s’est construit/constitué. Et pour ce faire je dois, à un moment, sortir de l’immédiateté et du « faire » permanent. Mais si on en revient à la citation originale de Filliou par M. Fréchuret, moi aussi je désire/décide/choisis alors déjà beaucoup trop !
Sophie Lapalu : Robert Filliou a su faire de l’échec et de l’impossibilité de véritables matériaux d’expérimentation artistique et philosophique, mais il est important de revenir aux conditions d’énonciation de cette phrase. D’où parle-t-il ? A quelle époque écrit-il ? Qui est-il ? Filliou est un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, inscrit dans un monde de l’art occidental (que l’on peut facilement qualifier de sexiste). Bien que légèrement alcoolique, sans le sou et « sans talent », il est malgré tout dominant. Il peut donc énoncer vouloir se défaire de tout. Au contraire, peut-on dire à une jeune artiste femme de faire sienne le fait de ne rien décider, quand bien souvent l’on décide déjà à sa place ? À un⋅e artiste transgenre d’être juste conscient⋅e de iel-même ? A un⋅e artiste immigré⋅e de rester assis⋅e calmement sans rien faire ? Ce serait indécent.
Et puis cette phrase est à entendre selon une pensée bouddhiste qui cherche à se détacher du désir (et donc de la souffrance) pour atteindre la plénitude.
FG : Pour poursuivre cet entretien, je vous propose de rencontrer le collectif somme toute et de poursuivre avec eux la réflexion autour des notions de visibilité, d’identification, de faiblesse et de dilution de l’art.
Entretien élargi avec Marc Buchy, Anna Coulet, Pierre Olivier Dosquet, Julieta Garcia Vasquez, Sophie Lapalu, Sandino Scheidegger, Liv Schulman et le collectif somme toute.
1.Entretien réalisé pour la revue Tête à Tête n°8 « Disparaître » – 2017 et lisible sur le blog de Sophie Lapalu
3.« Memory can only recall the « art » in the « art object », the object itself lives a life on its own – and just doesn’t care if we humans call the object art. What we call art or not, is a claim that we tell and which may live on in a story, but stories always vanish with the last person remembering it. Of course stories can be written down and therefore kept alive artificially, but it will be merely a story in the ocean of other stories called history. »
4.Framapad
5.« Les doubles de l’artiste« , Julie Ackerman Revue Mouvement n°101, mai-juin 2019, p.38-42
7.Renate Lorenz, Art queer, une théorie freak, Paris, éditions B42, 2018, p.41.
8.« Là, tous ceux qui bégaient doivent aussi boiter » de Karin Harraser publié dans Time and (In) Completion. Images et performances du temps dans le capitalisme tardif, Zagreb, BadCo, 2014.