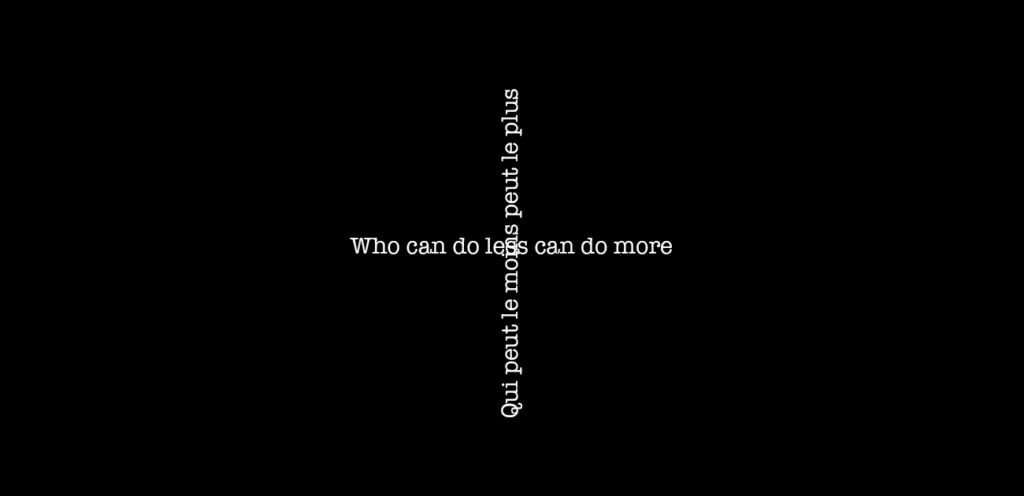Et si l’on visait à faire disparaître tout art qui ne trouve pas son public ? C’est le postulat ironique posé par l’artiste française Anne-Valerie Gasc qui promet d’éliminer toutes ses œuvres qui n’auront pas trouvé collectionneurs. Si on l’écoutait, les réserves seraient moins encombrées.
[wptpa id= »23″]
En 2008, l’artiste française Anne-Valérie Gasc imagine un projet artistique pour lequel elle apparaît sous le nom « Entreprise Gasc DémolitionTM » : l’exposition de sept blocs blancs présentés sur socle, modules architecturaux génériques ou sculptures, la chose n’est pas claire. L’exposition est astreinte à un protocole sévère : tous les deux jours, en l’absence d’une vente qui viendrait stopper le processus, un Bloc est détruit. Le projet dure donc quatorze jours. Une salle de l’exposition est entièrement dédiée aux foudroyages1.
Commentaire de la revue en ligne Paris-Art au sujet de l’exposition2 : « Anne-Valérie Gasc s’approprie des process éloignés a priori du territoire de l’art lorsqu’il est occupé par l’idée de conservation ». Et, de fait, les foudroyages en cas de non-vente présentent un gros inconvénient et deux gros avantages. Inconvénient : ne subsistent dans le sillage de l’artiste que des œuvres ayant eu du succès auprès d’un public. Le corpus est incomplet et sera pour toujours incomplet. Mais ceci peut-être également vu comme un avantage : ne subsistent alors que les œuvres ayant généré une interaction. Uniquement celles-là méritent de survivre. Les foudroyages en cas de non-vente d’Anne-Valérie Gasc présentent un autre avantage, il est de taille : pas de stock, les œuvres sont soit acquises, soit détruites. L’artiste peut repartir légère.
Art, économie, valeur. Pour quelles articulations ?
Existe-t-il des œuvres sans valeur pécuniaire mais ayant pourtant une valeur sur le plan de l’art ? On ne peut que répondre par un oui, c’est évident. À l’inverse, l’absence de valeur pécuniaire peut-elle agir négativement sur l’œuvre d’art, au point de l’éclipser ? Dans une autre Chronique de la soustraction, nous évoquons le Salvage Art Institute, plateforme de recherche new-yorkaise dédiée aux œuvres détériorées ayant perdu toute valeur et rangées pour toujours dans les réserves des groupes d’assurance ayant dédommagé leurs infortunés propriétaires.
On aimerait apprécier l’art pour lui-même, la chose est non seulement possible, mais surtout désirable, mais ce serait oublier « ce qui fait les prix » et « ce que les prix font ». À Paris, entre 2014 et 2016 s’est tenu un séminaire intitulé « Choses de prix ». D’après son initiateur, le philosophe français Patrice Maniglier, « Chose de prix est le résultat du travail d’un collectif associant des praticiens de l’art (artistes, curateurs, critiques, collectionneurs, etc.) et des praticiens des sciences humaines et sociales (sociologues, anthropologues, économistes, philosophes, historiens de l’art et de la littérature), qui se sont réunis pendant deux ans autour du prix des choses, ou plus exactement, de ce que le prix fait aux choses. » Maniglier, toujours : « Nous nous sommes demandé ce que signifiait, pour une chose, d’avoir un prix, et de passer, par exemple, du cadeau à la marchandise, de l’objet de collection à la relique, de l’échantillon gratuit au déchet. Il nous a semblé que les choses d’art étaient un laboratoire privilégié pour observer ces mécanismes, ne serait-ce que parce que les principes de formation des prix y sont particulièrement obscurs. »
Mais revenons-en à notre pivot, la soustraction : en 2019, valeur ou pas, est-il encore pertinent de réaliser des œuvres d’art ? On ne peut que constater qu’il y en a trop. Les cas de figure qui voient les artistes anéantir leurs œuvres sont très nombreux. Si nombreux que l’on peut parler sans se tromper d’une histoire de l’art alternative qui peut être mise en parallèle avec l’aventure des gnostiques telle que la décrit l’écrivain français Jacques Lacarrière. Une « histoire de l’ombre, une contre-histoire dont les nappes successives tentent désespérément de nier l’histoire elle-même ». « Les gnostiques », écrit Lacarrière, « se moquent de la postérité, de la pérennité, du futur, de tous ces pièges et ces filets du temps où les hommes se laissent prendre ». « Ce qu’ils prônent, c’est une fuite immédiate, une désertion hors du monde et des siècles. »
Patrick de Haas, maître de conférences en histoire de l’art contemporain à la Sorbonne, remarque d’autre part qu’il y a « deux façons d’empêcher qu’une œuvre dérangeante ne produise ses effets : ou bien la détruire physiquement, si possible jusqu’à son souvenir, ou bien la muséifier, si possible jusqu’à l’anesthésie complète. »
Achevons cette chronique en abordant un autre phénomène. Celui des artistes qui quittent l’art. Ici aussi, les cas de figure abondent depuis plus d’une centaine d’années. Leurs raisons sont extrêmement diverses.
C’est le cas de l’artiste conceptuel Alexander Melamid, d’origine russe et basé à New York. D’après le New York Times3, à partir de 2004, après une période faste durant laquelle il « célèbre et pourfend la culture de masse » en duo avec un autre artiste, Vitaly Komar, lui aussi américain d’origine russe, Melamid quitte les circuits officiels de l’art pour « devenir underground ». Il dit « avoir perdu sa foi ». Ne le voyant plus apparaître pendant longtemps, certains se demandent même s’il n’a pas tout simplement abandonné son activité d’artiste. Où est passé Alexander Melamid ? Toujours dans le New York Times, quelques années plus tard, soit en 2014, dans un entretien avec la journaliste Penelope Green, Melamid qui n’a toujours pas disparu, se confesse, il dit : « l’art n’est pas seulement une pollution physique, c’est aussi une pollution intellectuelle, une pollution spirituelle. Nous étions promis au salut par l’art, et je dois affirmer que j’étais un croyant passionné. Jusqu’à ce que je réalise que c’était une forme de subordination parmi d’autres, encore un de ces enseignements semi-religieux à la Mary Baker Eddy ou Madame Blavatsky (un des membres fondateurs de la Société Théosophique). » L’entretien se poursuit ainsi : « À l’attention de toutes celles et ceux qui essaient de sortir de l’affliction que leur provoque le fait d’être dans l’art, pourquoi ne pas créer un nouveau cursus, des cours d’électricité ou de plomberie ? ». La chose prête à rire. Pourtant Alexander Melamid est sérieux. Fin 2014, il se fait remarquer avec un projet incongru, le « Melamid’s Institute of Responsible Re-Education4 ». Créé à New York, l’Institut est une collaboration avec Phillip Gulley, dont on ne sait à peu près rien, sinon qu’il est un entrepreneur. Que propose l’Institut ? De rééduquer tous les artistes qui souhaitent quitter l’art. « À toutes celles et ceux qui se sont formés en écoles d’art », dit la note d’intention qui circule alors sur l’Internet, « arrachés de leurs rêves par la dure réalité – pas de tonnes d’argent, mais un avenir de pauvreté, pas de succès monumental, mais des opportunités ratées », « nous offrons la possibilité d’obtenir des certificats dans les métiers suivants : réparation d’appareils, réparation automobile, AutoCAD, menuiserie, garderie de jour, aménagement paysager, toilettage, plomberie, sécurité, etc. »
La chose la plus improbable dans cette affaire, c’est qu’il n’existe plus une seule trace de l’Institut seulement cinq ans après sa création.
C’ÉTAIT : S’interdire de faire des objets d’art comme soustraction.
Couverture : © Anaïs Enjalbert