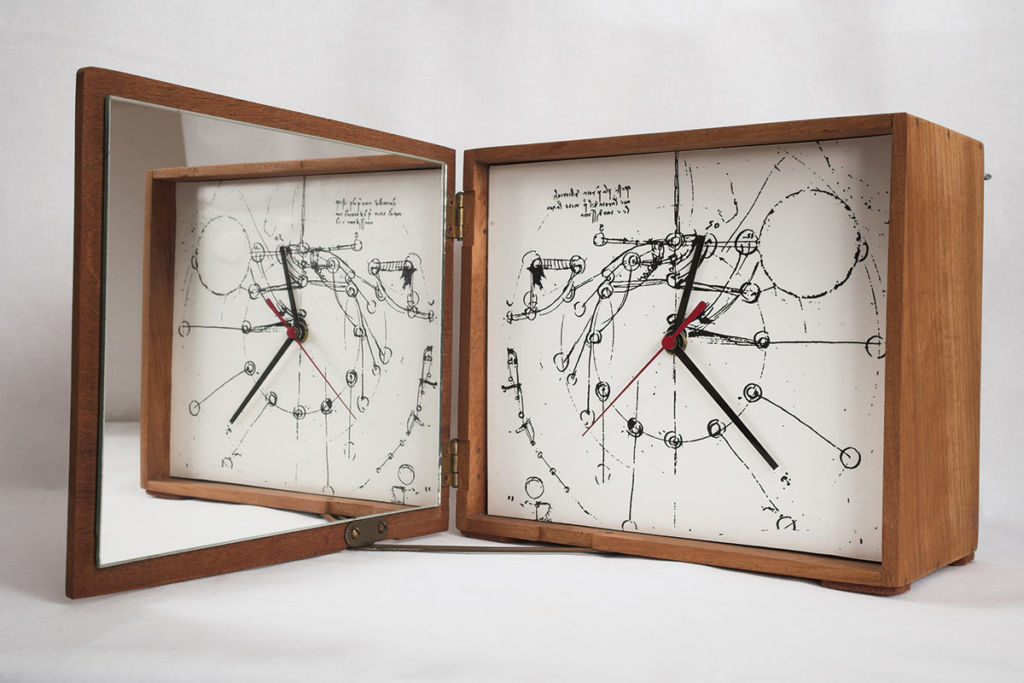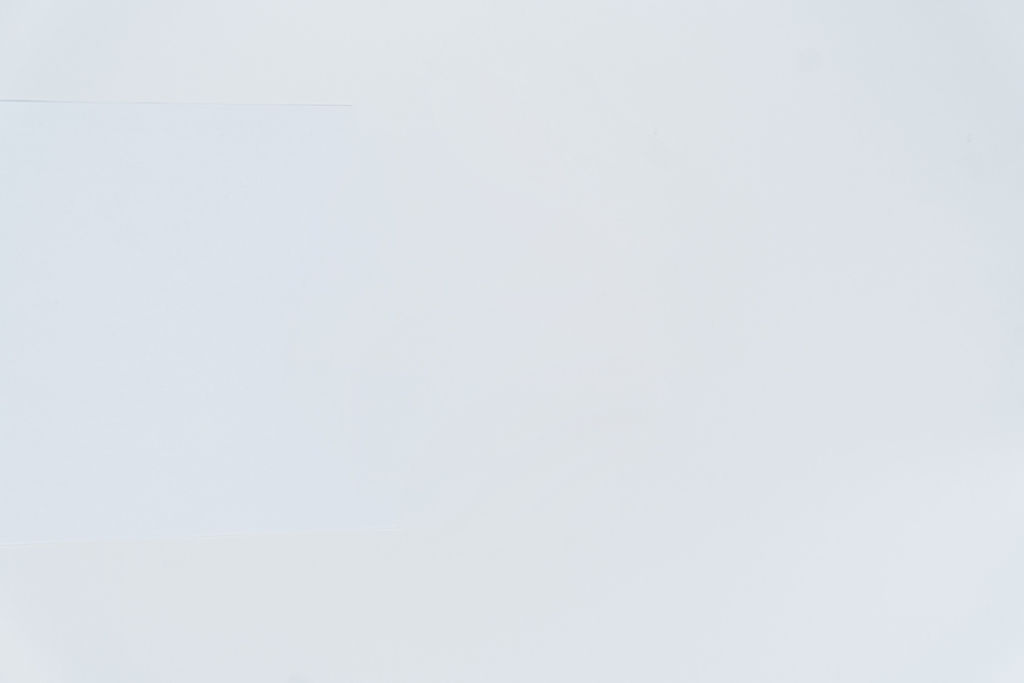L’assimilationnisme culturel est un leurre Entretien avec Marco Martiniello
Entretien par Christian Rinaudo
Partant de sa propre expérience et inspiré par ses travaux de recherches, le sociologue et politologue italo-belge Marco Martiniello livre à Switch (on Paper) son regard quant aux incidences de l’immigration sur les évolutions culturelles, notamment à Liège, une ville-laboratoire où il a grandi et travaille encore.
Christian Rinaudo : Vous êtes sociologue, d’origine italienne, installé en Belgique depuis de nombreuses années. Vous avez également vécu et travaillé aux États-Unis. Pourriez-vous nous retracer les grandes lignes de votre parcours intellectuel et les orientations de valeur qui ont guidé vos recherches ?

Immigrants italiens en gare de Brig, en Suisse (1956)
Marco Martiniello : En fait, je suis né en Belgique en 1960 dans une famille de travailleurs immigrés du Sud de l’Italie. Mon père est arrivé en Belgique en 1947 dans le cadre des accords migratoires entre la Belgique et l’Italie signés en juin 1946. Il devait en principe travailler dans un charbonnage de la région de Charleroi mais il a refusé de descendre dans la mine. Il a failli être expulsé et il s’est finalement retrouvé dans une carrière de pierres d’abord, près de Namur puis dans la banlieue de Liège, à Flémalle. Ma mère et ma sœur sont arrivées en 1950. Ma sœur est née en Italie en 1947, 26 jours avant le départ de notre père pour la Belgique. Ils ne se sont revus que 3 ans plus tard dans la grisaille d’un novembre belge. Je suis né 10 ans après l’arrivée de ma mère et de ma sœur, à la maternité d’Ougrée qui se situait en plein bassin sidérurgique liégeois, juste en face du Stade du Standard de Liège. J’ai grandi dans un quartier ouvrier où les familles immigrées italiennes, grecques, polonaises et espagnoles étaient nombreuses. Mes parents avaient réussi à épargner pour acheter une toute petite maison de 4 pièces sans salle de bain et sans chauffage. A la fin des années 60, mon père travaillait dans une usine chimique et ma mère faisait des ménages. Pendant les vacances scolaires, il m’arrivait de l’accompagner. Mes parents n’ont jamais eu de voiture. Nous avons eu le téléphone et la télévision assez tard. Les priorités étaient la nourriture, agrandir la maison et notre éducation. Le reste, c’était du superflu à l’exception du football que je pratiquais depuis l’âge de 9 ans et qui rythmait la vie de la petite famille. Mes parents travaillaient dur toute la semaine mais le dimanche, c’était sacré : je jouais au foot et toute la famille me suivait.

Mineurs italiens venus travailler en Belgique dans le cadre du programme « Des bras contre du charbon », protocole signé à Rome le 23 juin 1946.
Je ne raconte pas cela pour étaler ma vie mais simplement parce que mon parcours intellectuel est profondément ancré dans ce milieu ouvrier immigré matériellement pauvre mais si riche en valeurs et en amour familial. Mon père était communiste. Je l’ai toujours entendu fustiger le grand capital et les fascistes. Les premiers l’exploitaient. Les seconds avaient gâché sa jeunesse. Ses amis et compagnons de travail étaient Italiens, Grecs, Marocains, Algériens, Espagnols. Il était membre du PCI. Pour lui, il était normal de revendiquer ses droits. Il était de toutes les grèves qui se multipliaient à cette époque. Et toujours il m’expliquait pourquoi ce système capitaliste était injuste et comment les gens d’en haut s’enrichissaient sur la sueur de ceux d’en bas ; comment ils divisaient la classe ouvrière en groupes (les Belges et les immigrés) pour mieux les dominer.
Je ne comprenais pas tout ce qu’il me disait mais je reliais ses propos à mes expériences d’enfant et je m’interrogeais. Pourquoi dans la cour de récréation, les équipes de football se constituaient sur la base de la nationalité : les Belges contre les étrangers ? Pourquoi, alors que je travaillais très bien à l’école, l’orientation scolaire me destinait-elle à l’école professionnelle tandis que mes condisciples belges moins performants étaient orientés vers le lycée qui est une étape vers l’université ? Pourquoi, dans mon équipe de foot, étions-nous en grande majorité des étrangers ? Pourquoi certains condisciples me traitaient-ils de ‘sale macaroni’ et me disaient-ils que je devais retourner dans mon pays ?
Toutes ces questions, je les emmenai avec moi au lycée dans lequel mes parents m’avaient inscrit contre l’avis de l’orientation scolaire. Jeune adolescent, je découvris alors le mouvement hippie qui perdait de sa force, les Brigate Rosse, la Rote Armee Fraktion, le mouvement Punk, les luttes tiers-mondistes, les luttes des immigrés pour les droits sociaux et politiques, les mouvements antifascistes dans un cocktail idéologique pas très cohérent. Durant mes premières années au lycée, je voulais devenir journaliste et aller à l’école de journalisme de Lille alors très réputée. Arrivé au moment du choix, la faiblesse des ressources financières disponibles me conduisit à privilégier l’université la plus proche, l’Université de Liège où je m’inscrivis en sciences économiques et sociales dans l’espoir de bifurquer plus tard vers le journalisme à Lille. Ma première année à la faculté fut loin d’être un succès. J’éprouvais des difficultés à trouver ma place parmi cette jeunesse dorée bien habillée qui venait en cours en voiture. Le choc culturel fut rude. Les enfants de prolétaires, immigrés qui plus est, étaient noyés dans cette progéniture des classes moyennes et supérieures locales. Je continuais à jouer au football maintenant à un niveau national. Nous jouions dans toute la Belgique. Et là, je pus expérimenter la haine et une certaine forme de racisme de la part des supporteurs de nombreuses équipes flamandes. Notre équipe alignait une majorité de joueurs « d’origine non belge ». Dès que le speaker du stade donnait la composition des équipes, nous entendions les huées puis les insultes des supporters adverses à notre égard. Les ‘macaronis’ fusaient ainsi que les ‘Walen buiten’ (les Wallons dehors). A chaque déplacement en Flandre, c’est ce que vous vivions et souvent, cela nous motivait et nous rassemblait. Tout me renvoyait constamment à mes origines populaires d’immigré.

Les sidérurgistes de Cockerill, Italiens et Belges solidaires, manifestent pour les 36h/semaine à Seraing, dans la Province de Liège, en 1976 © Photographie Institut d’Histoire Ouvrière, Économique et Sociale – IHOES (Seraing)
Plus ou moins au même moment, le virus des sciences sociales me gagna. J’étais fasciné par Karl Marx et Pierre Bourdieu mais aussi par Erving Goffman et Wright Mills. Je vouais une admiration sans borne aux travaux de Gramsci dont la subtilité m’impressionnait. Ces auteurs me firent renoncer à mon plan de rejoindre l’école de journalisme de Lille. Je décidai de rester à Liège en Sociologie. L’année où je devais choisir un thème pour mon mémoire de fin d’études, mon père fut contraint de prendre sa pré-retraite. Son usine restructurait, comme on disait pudiquement. La crise économique avait frappé. Pour moi, il était clair que j’allais travailler dans le domaine des migrations. Je pensais que la sociologie des migrations allait donner une réponse à mes questions quasi existentielles et réellement expliquer pourquoi nous étions en Belgique et prévoir ce qu’il allait advenir de nous maintenant que mon père n’était plus un travailleur immigré mais une aberration en Belgique : un pré-retraité immigré. Car, comme l’expliquait Abdelmalek Sayad, la présence d’un immigré qui ne travaille plus n’est plus légitime aux yeux de la société. Clairement, une quête personnelle liée à l’histoire migratoire de ma famille est à l’origine de mon choix de m’orienter vers la sociologie des migrations et en particulier vers les projets de retour au pays chez les immigrés. Durant ce travail, je me plongeai dans les écrits de Sayad qui reste, selon moi, l’un des plus grands penseurs au monde sur les migrations. Mon mémoire fut très bien reçu, j’obtins le diplôme de sociologie avec grande distinction. Lors de la proclamation des résultats, on nous conseilla de ne pas oublier de nous inscrire à l’ONEM, l’équivalent belge de l’ANPE. La joie et la fierté avaient été de courte durée : je devins un chômeur diplômé dans une région en profonde crise économique et sociale.
Je m’engageai assez rapidement et à titre bénévole dans une association immigrée italienne proche du PCI dans l’espoir d’y décrocher un contrat de recherche sur la seconde génération des immigrés italiens. Cela se produisit dans le cadre d’un programme de mise à l’emploi des jeunes. L’expérience fut cruciale pour moi car c’est à ce moment que mon projet de thèse de doctorat vit le jour. J’étais fasciné par la vie associative des immigrés et en particulier, par le rôle des leaders associatifs. C’est aussi l’époque où, insatisfaits de notre formation philosophique, plusieurs d’entre nous, actifs dans le monde associatif, décidâmes d’organiser nos propres cours animés par un prêtre ouvrier italien, proche du courant de la théologie et la libération et ancien étudiant du grand philosophe italien Nicola Abbagnano. Cette époque était intellectuellement et humainement très riche. Nous étions à la fois ancrés dans le terrain et dans les débats théoriques (sociologique, politiques et philosophiques) souvent d’inspiration marxiste mais toujours critiques vis-à-vis de son orthodoxie. A posteriori, je peux dire que ces deux années furent le berceau de mon positionnement de chercheur.
Ensuite, je parvins à obtenir un contrat d’un an à l’Université de Liège pour réaliser une recherche quantitative sur la démocratisation du public de l’opéra, au service d’un de mes anciens professeurs. Je revenais donc à l’université tout en maintenant mon engagement associatif et nos cours autogérés de philosophie. J’appris à réaliser une enquête quantitative de grande ampleur. Je commençai à réellement comprendre les avantages et surtout les problèmes de ce type d’enquête qui repose sur, ou renforce parfois, une tendance à n’accorder de crédit qu’aux faits que l’on peut chiffrer. C’est probablement à ce moment que je devins le qualitativiste que je suis encore aujourd’hui.
J’entretenais à cette époque des contacts réguliers avec mon ancien professeur de méthodologie, Paul Minon. Je lui faisais part de mon envie de me lancer dans un doctorat. Il me faisait part des difficultés d’obtenir une bourse du FNRS (l’équivalent belge du CNRS) ou un mandat d’assistant pour le faire. Jusqu’au jour où, dans un couloir, son attention fut attirée par un poster de l’Institut Universitaire Européen de Florence (IUE) qui avait déjà attiré la mienne. Il me dit « pourquoi n’essayez-vous pas d’aller à Florence ? ». C’était le début d’une grande aventure. J’étais de nationalité italienne. La Belgique refusait de prendre ma candidature en compte. Les bourses doctorales qu’offrait la Belgique étaient réservées aux citoyens belges. Je devais donc entrer en compétition avec les candidats italiens, beaucoup plus nombreux, pour obtenir une bourse du gouvernement italien. Au second essai, j’obtins l’une des 8 bourses italiennes sur 109 candidat.e.s. J’allais donc m’installer dans le pays que mes parents avaient quitté, dans une ville que je ne connaissais pas et dans une institution très élitaire pour au moins trois ans.
Cette expérience florentine allait être également cruciale. L’endroit, d’abord, était magique, somptueux, d’une beauté rare. Au niveau social, je me retrouvais pour la première fois dans un milieu international de très haut niveau et il ne fallut pas longtemps pour que les profils atypiques de toutes les nationalités se trouvent, se rassemblent et socialisent. Les professeurs en résidence ou de passage étaient impressionnants et accessibles. En 1986, très peu de doctorants travaillaient sur des réflexions liées aux migrations à l’IUE. Pour combler ce manque, nous avions créé un groupe informel et interdisciplinaire où discuter entre nous de nos thématiques de recherche. Le problème de l’immigration était en train d’exploser dans la société italienne. Je pus aussi trouver un ancrage de terrain grâce notamment aux contacts que j’avais noués avec des « leaders » sénégalais de Florence. C’est durant ces 4 années à Florence que j’approfondis mes connaissances de la littérature anglophone sur les migrations et le racisme qui allaient donner l’ossature théorique de ma thèse de doctorat.
Je terminai ma thèse en 1990 et ma compagne et moi décidâmes de rentrer en Belgique après cette expérience florentine qui changea à tout jamais notre vie, mais pas notre passion pour la recherche. Une recherche aussi solide que possible au niveau théorique, une recherche toujours ancrée dans le terrain, une recherche de plus en plus collaborative et internationale, une recherche critique mais jamais destructrice, une recherche permettant le dialogue avec les autorités, mais jamais soumise à celles-ci, une recherche se nourrissant du débat d’idées dans le respect. Ce sont les valeurs qui ont dicté ma conduite dans mon métier au cours des 30 dernières années qu’il serait trop long de passer en revue ici.
CR : Vous avez longtemps travaillé sur la représentation des populations d’origine immigrée et des élus d’origine étrangère, en Belgique et dans différents pays d’Europe. Depuis quelques années, vous vous intéressez également aux expressions artistiques des minorités ethniques dans les villes européennes, à la participation culturelle de ces mêmes populations, aux manières de consommer la culture, de s’impliquer dans des pratiques telles que la musique, la danse, le théâtre, etc. Comment vous est venu le fait de vous intéresser dans vos travaux aux pratiques culturelles et artistiques des migrants et des populations d’origine immigrée en Europe ?
MM : Comme vous l’avez dit, j’ai beaucoup travaillé sur la participation et la mobilisation politiques des immigré·e·s et de leur.s descendant.e.s. dans une perspective classique en sociologie politique. L’émergence des candidats et des élus d’origine étrangère dans les élections locales m‘a beaucoup intéressé de même que la recherche des particularités éventuelles du vote des populations immigrées ou d’origine immigrée, là où elles avaient le droit de vote. Au bout de quelques années, j’avais le sentiment d’avoir fait le tour de la question. Il devenait difficile de faire émerger de nouvelles hypothèses et d’aller beaucoup plus loin dans la réflexion théorique. J’étais de plus lassé de la tendance des politistes à confiner le débat sur la mobilisation et la participation des migrants et des minorités au cadre des institutions politiques conventionnelles. Il me semblait opportun de revenir à l’étude des formes non conventionnelles d’expression et de mobilisation politiques. Parmi elles, les arts et la culture occupent une place importante. Par la suite, je me suis posé d’autres questions : comment l’immigration contribue-t-elle à modifier le paysage artistique et culturel des pays d’installation permanente ou temporaire ? Les arts et la culture permettent-ils aux différentes populations de nos sociétés superdiversifiées de se rencontrer et de faire société ? Comment les politiques culturelles et artistiques peuvent-elles répondre à la diversification culturelle de la société ? J’imaginais mal, quand j’ai commencé à travailler sur la musique comme forme d’expression politique des minorités ethniques et culturelles, que j’avais ouvert une boîte de Pandore dans laquelle je me débats avec plaisir aujourd’hui encore.

Tribune des tifosi du Standard de Liège © Creative Commons
CR : Vous travaillez à l’Université de Liège où vous dirigez depuis plusieurs années le Centre d’Études de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM). En même temps, vous êtes beaucoup investi dans la vie artistique culturelle locale, en particulier aux côtés des minorités ethnoculturelles qui s’impliquent politiquement à travers différentes formes d’expression artistique. Quel est le sens de cet engagement et comment le reliez-vous à votre travail académique ?
MM : En fait, notre conception de la recherche au CEDEM accorde une importance cruciale à la combinaison de la réflexion théorique, du travail empirique et de l’engagement citoyen, quelle que soit la thématique sur laquelle nous travaillons. Dans nos travaux sur les arts et la culture en relation avec les migrations et les minorités, nous avons beaucoup réfléchi aux pratiques de co-création de savoir et plus largement aux différentes modalités de partenariat avec les acteurs et actrices dans monde de la culture. J’ai toujours pensé que la rencontre entre la sphère académique et les autres sphères sociales devait aller bien au-delà d’une interaction plus ou moins furtive entre un chercheur et une personne interviewée dans le cadre d’une enquête. Je pars du principe que les personnes interviewées ont toujours mieux à faire dans la vie que répondre à nos questions. Nous nous devons donc de leur apporter quelque chose en retour et de valoriser leur savoir et leur expertise. Le minimum que l’on puisse faire, et on le fait toujours, c’est les informer en priorité des résultats de nos recherches. Mais en plus, nous souhaitons les impliquer dans nos réflexions et dans la diffusion de nos résultats. Dans la plupart de nos colloques et conférences, des artistes et des opérateurs du secteur artistique ont été invités à prendre la parole, et pas seulement à titre décoratif. A l’inverse, nous sommes régulièrement invités à participer à des projets émanant du monde artistique et culturel. C’est ainsi par exemple que lors des célébrations pour le 70e anniversaire des accords bilatéraux entre la Belgique et l’Italie sur les migrations, je me suis retrouvé sur scène pendant plus de 2 heures devant 600 personnes en qualité de maître de cérémonie d’une soirée multidisciplinaire (musique, cinéma, conférences, lectures, entretiens) organisée à l’initiative du Théâtre de Liège. C’est ainsi également que je me suis retrouvé un jour dans le studio de jeunes rappeurs liégeois à écouter le morceau qui leur avait été inspiré par la lecture de l’un de mes articles. Dans mon expérience, les liens humains tissés au départ de la recherche peuvent tantôt se renforcer, tantôt se relâcher. Mais, ils survivent à l’épreuve du temps.

Photogramme extrait du film d’animation d’Alain Ughetto, « Interdit aux chiens et aux Italiens » présenté au festival d’Annecy en 2020.
CR : Sous quelles formes les migrants et leurs descendants s’insèrent-ils dans la scène artistique liégeoise ? Dans quelle mesure leurs productions artistiques sont-elles reconnues et soutenues par les institutions culturelles et en quoi ce que vous observez à Liège est-il différent ou similaire de ce que vous avez pu constater dans d’autres villes d’Europe ?
MM : Les Liégeois aiment penser que leur ville est particulière, unique même, notamment en raison de son histoire faite de 8 siècles de quasi indépendance politique. Je ne sais pas si Liège est unique. En revanche, il me semble qu’elle se caractérise par une vie culturelle extrêmement développée et diversifiée au regard de sa taille. C’était le cas avant cette crise sanitaire qui a tout mis à l’arrêt ou presque. J’espère que la renaissance culturelle est pour bientôt.
Au-delà des grandes institutions culturelles comme l’Opéra Royal de Wallonie, le Théâtre de Liège et l’Orchestre Philharmonique de Liège, la ville regorge de lieux et d’espaces culturels plus underground que ce soit dans le théâtre, la musique ou les arts plastiques, et plus largement dans le secteur événementiel. Ce n’est pas pour rien qu’on appelle Liège la cité ardente en Belgique.
Si les grandes institutions culturelles sont internationales par vocation, que ce soit dans leur programmation ou dans leur staff, c’est surtout dans ces autres espaces culturels que les immigrés et leurs descendants trouvent des espaces d’expression. Je citerais peut-être en particulier les arts urbains et le théâtre. A Liège comme dans beaucoup d’autres villes, des jeunes immigrés ou d’origine immigrée ont joué un rôle crucial dans le développement de toutes les disciplines du hip-hop, par exemple. Dans le domaine du théâtre, la thématique des migrations portée par des troupes composées notamment de comédien.ne.s ayant une expérience migratoire a permis le développement d’une scène de théâtre-action assez puissante.
Par ailleurs, la réflexion sur la diversité s’est fortement développée au sein du Théâtre de Liège, lequel a été impliqué dans différents projets européens sur l’immigration. Cette institution s’est de plus en plus ouverte à l’ensemble de la société. Elle est devenue beaucoup plus inclusive que par le passé. Mais il s’agit plus de la volonté de l’actuelle direction que d’une impulsion qui serait donnée par le pouvoir politique.
CR : Jusqu’ici, vous avez beaucoup travaillé sur les pratiques artistiques et culturelles des migrants et des minorités ethnoculturelles dans les villes d’installation. Que sait-on de ces pratiques ? Sont-elles arrivées en suivant les routes migratoires ? Sont-elles nées dans les quartiers des grandes villes européennes ou sont-elles le fruit des reconfigurations locales de pratiques mondialisées ? En d’autres termes, que doivent-elles aux cultures d’origines, à la superdiversité des villes et aux circulations transnationales des pratiques culturelles et artistiques ?
C’est une vaste question qui ne peut trouver que des réponses différentes en fonction du contexte géographique et historique. Mais d’une manière générale, les pratiques artistiques des migrants et de leurs descendant.e.s doivent à la fois aux cultures des pays d’origine, aux cultures présentes dans les villes et à la circulation transnationale des formes artistiques. C’est remarquable notamment dans la musique de l’époque du groupe Carte de Séjour jusqu’à celle d’Aya Nakamura. Mon collègue Phil Kasinitz a montré comment Broadway est largement une construction due aux artistes immigrés d’abord juifs européens. Le cinéma allemand a été renouvelé sous l’impulsion de Fatih Akin. La littérature anglaise doit beaucoup à Hanif Kureishi ou Linton Kwesi Johnson. Je pourrais citer des dizaines d’exemples. Toute perspective assimilationniste sur la question des arts et de la culture est un leurre. Les immigré.e.s ne se contentent pas de s’assimiler à la culture nationale, pour autant que cette expression ait un sens. Ils et elles la modifient, la diversifient et souvent l’enrichissent.
Couverture : L’arrivée d’une famille italienne en gare de Vivegnis, près de Liège (1956) © Photographie, Musée de la Vie wallonne.