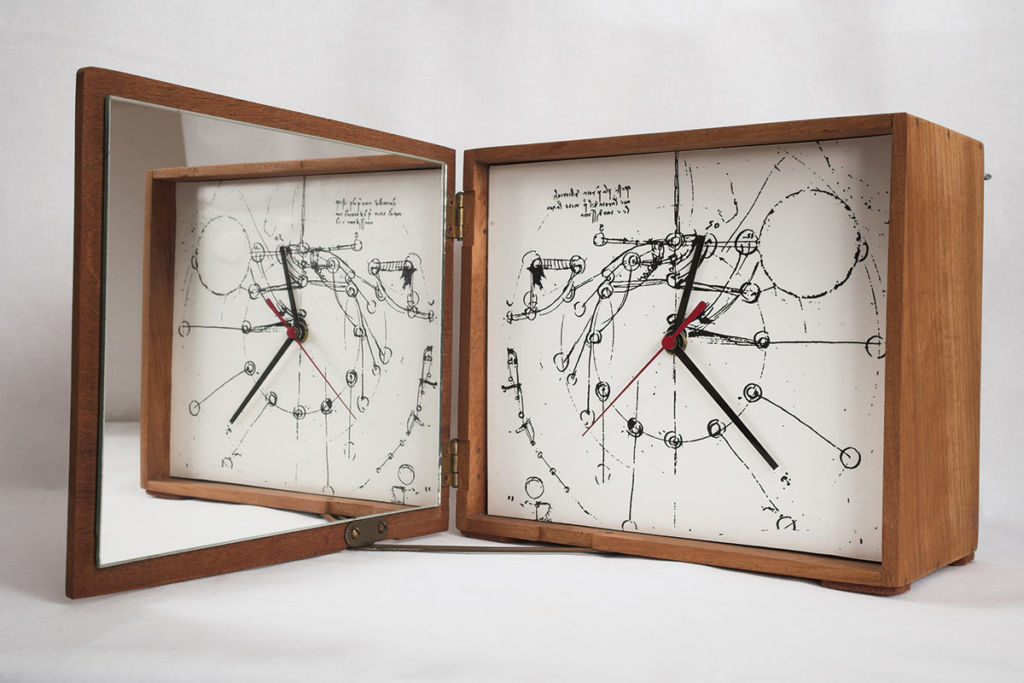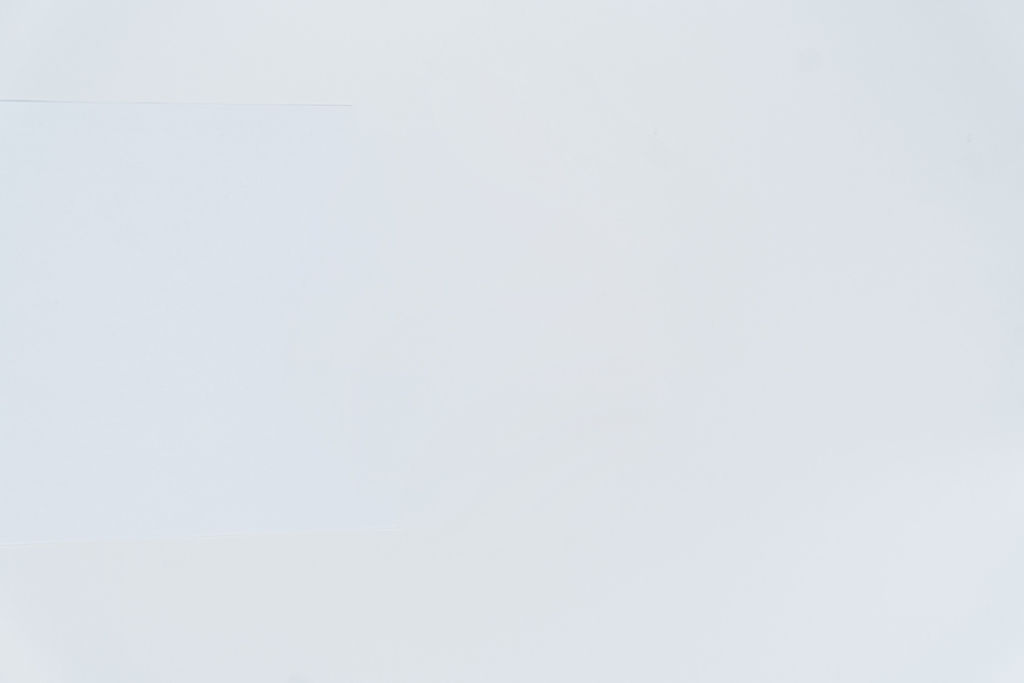Depuis plus de vingt ans, l’artiste et auteure Suisse Ursula Biemann traite dans ses essais vidéo des défis écologiques contemporains, comme l’extractivisme et l’accès inégalitaire aux ressources de la Terre – ou encore les flux migratoires, conséquences de la pression exercée par l’homme sur l’environnement et le monde du vivant. Plus que jamais, l’actualité confirme la pertinence de cette vision complexe, reliant cette voracité dans l’exploitation des ressources et les transformations irréversibles des sols et d’écosystèmes entiers aux enjeux sociaux et environnementaux les plus brûlants.
Très informée des recherches scientifiques en cours et des débats philosophiques et anthropologiques autour des enjeux écologiques, l’artiste instille dans son œuvre filmée des visions éco-féministes où conceptions féministes et écologiques se rejoignent pour s’élever contre la surexploitation de la nature et la marchandisation du vivant, et promouvoir des gestes de réparation. Elle fait écho à l’inclusion de représentations cosmologiques dans le droit international, et donne voix à des perspectives non-humaines – en d’autres termes la prise en compte des modes de pensée des autres êtres vivants.
Loin de céder au catastrophisme ambiant, Ursula Biemann invite à réapprendre notre appartenance originelle à l’ordre naturel et écouter le témoignage de peuples qui vivent dans une relation riche et respectueuse avec le non-humain. Cet entretien revient sur quelques-unes de ses œuvres clés réalisées depuis 2012 ; sur des enjeux intellectuels, anthropologiques, scientifiques, soulevés dans son travail et sur son exploration de la figure du scientifique indigène.
Hélène Guenin : Ursula, à la fin des années 1990, tu as initié une série d’essais vidéo explorant des contextes et enjeux de mobilité, de migration, les points de tensions ou mécaniques d’aliénation qui se cristallisent mondialement au niveau des frontières Nord-Sud, comme dans Performing the Border ou Europlex. Très vite, tu as mis en évidence des géographies de l’exploitation, mettant en corrélation domination humaine, extraction de ressources naturelles et inégalité de leur redistribution comme dans Black Sea Files. À partir de Egyptian Chemistry (2012), et plus précisément de Deep Weather (2013), cette recherche a franchi une nouvelle étape en déplaçant la réflexion que tu menais sur la complexité des relations à un territoire et ses ressources vers des enjeux plus ouvertement écologiques : l’impact de nos actions sur des écosystèmes. Comment s’est opérée cette transition du « cartographique », du géopolitique et du social à une approche écologique ?

Ursula Biemann
Deep Weather, 2013
Ursula Biemann : Je ne cherche pas à dire que les domaines géopolitique et environnemental ne sont pas liés. À chacune de mes visites sur le terrain, j’ai pu observer le processus de dévastation effrénée de l’environnement, conséquence de l’accélération et de l’expansion stupéfiantes du capitalisme globalisé. Même lors de ma toute première visite à Ciudad Juarez, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où les industries numériques du Nord ont installé des centaines d’usines d’assemblage à bas prix, exploitant en masse une main-d’œuvre féminine provenant des provinces mexicaines pauvres, la responsabilité de ces entreprises – agissant en toute impunité – sur la contamination des sols et de l’eau m’est apparue de façon flagrante. Simplement, il s’agissait pour moi de me concentrer sur des sujets en théorie beaucoup plus intéressants pour moi à l’époque, à savoir les imbrications que l’on a vu apparaître entre les notions de frontière et de genre dans ce monde du travail globalisé, en d’autres termes, l’émergence d’une problématique de genre à l’œuvre dans ce nouvel ordre mondial.

Ursula Biemann
Deep Weather, 2013
Autre aspect, suggéré dans le titre même de cet essai vidéo, la performativité de la frontière en tant que lieu symbolique qui doit être constamment rejouée par ces corps genrés afin de conserver sa signification. C’est là que j’ai compris que ma propre action sur le terrain s’inscrivait non comme une simple tâche de représentation mais dans une action de construire véritablement un espace. C’est ce que signifie pour moi une pratique géographique, une forme symbolique de redéfinition de l’espace. Suivre ces corps à travers le monde, les voir migrer vers les chaînes de montage des multinationales et l’industrie du sexe en plein essor, m’a permis de constater l’ampleur impressionnante de l’exploitation. Je me suis alors intéressée à l’idée d’élaborer une construction visuelle qui mettrait en regard les théories féministes et les nouveaux discours sur la mobilité et la technologie. Ce travail a été suivi par une série d’œuvres pour tenter d’appréhender la transformation rapide des frontières européennes suite aux accords de Schengen, en traçant un système complexe de trajectoires à travers le Sahara et depuis les territoires de l’ex-Union Soviétique.
Je ne me suis jamais trop attachée aux histoires individuelles, j’ai plutôt adopté une approche systémique de ces phénomènes. De cette manière entre autres, mes essais vidéo se distinguent d’une approche journalistique. La géographie était purement dans ce cadre un outil esthétique pour comprendre le monde en transformation. Mais en 2010, il est devenu évident que cette représentation strictement cartographique et superficielle du monde était insuffisante. Les dégâts s’étaient infiltrés dans la terre depuis des décennies, dans l’eau, dans l’air, et jusque dans l’ensemble des corps vivants. La catastrophe avait pénétré la condition même de la vie sur terre. Nous devons accéder à une conscience planétaire alors que nous entrons dans une phase où chaque décision que nous prenons a des conséquences décisives pour notre avenir. Naturellement, je me suis concentrée sur les endroits où les crises environnementales étaient les plus criantes. L’écologie, en tant qu’ensemble vivant d’organismes interdépendants, se prêtait aussi bien à une structuration du récit. Les différentes formes d’écologie que j’ai abordées à travers mes vidéos comprenaient des éléments naturels mais aussi sociaux et technologiques. Elles ne sont surtout pas l’expression d’un désir nostalgique de revenir à un environnement purement naturel.
HG : Dans la vidéo Deep Weather, tu offres un parallèle saisissant entre deux géographies, deux situations écologiques catastrophiques et intimement liées, résultant des transformations profondes de la nature et du climat. Tu filmes notamment les mines de sables bitumineux du Nord du Canada, qui empiètent largement sur les forêts de la région, répandent leur noire pollution sur les paysages sauvages, détruisant faune et flore de l’Alberta, contaminant durablement les sols et les eaux. Ces images d’une troublante beauté, laissent ensuite place à celles de la construction d’une digue au Bangladesh, où la fonte des glaciers de l’Himalaya, l’élévation du niveau de la mer et les conditions climatiques extrêmes contraignent la population à un mode de vie amphibien et à une lutte permanente pour sa survie. Le film incarne par cette confrontation géographique les répercussions insoupçonnées de l’exploitation irraisonnée des ressources et les futurs imprévisibles que dessinent nos actions à l’autre bout du monde. Tu introduis par ailleurs une dimension qui me semble très importante à ce qui pourrait rester circonscrit à l’ordre du constat : un récit murmuré, une écriture très ciselée, qui donne à ce film une dimension de conte d’aujourd’hui, magnifique et glaçant et qui introduit l’idée d’une narratrice qui aurait la capacité d’avoir une méta-vision à l’échelle du globe. Peux-tu développer les enjeux de ce choix qui me semble annoncer le glissement vers la fiction que l’on retrouve dans tes œuvres les plus récentes, et revenir sur le choix de confrontation de ces deux géographies ?
UB : Je n’ai jamais vu de dévastation d’une telle ampleur (que celle du Nord du Canada). Les déchets toxiques produits par le traitement du bitume sont stockés dans des lacs de résidus à ciel ouvert qui s’étendent sur de vastes zones, jusqu’à récemment couvertes d’anciennes forêts d’épicéas. L’exploitation minière agressive, les vapeurs de traitement, le transport par camion des sables bitumineux portent tous atteinte à l’environnement et aux droits humains, car ils détruisent l’espace vital et les territoires de chasse des communautés des Premières Nations. Mais pour le peuple Cri (Cree) qui vit dans la région de l’Athabasca, le préjudice va bien au-delà de l’entrave à leur culture traditionnelle ou leurs pratiques de chasse. Les mythologies et divinités locales animent leur territoire. Le paysage contient les deux mondes, c’est un habitat psycho-social. Le bruit, les ondes et les vibrations des sonars souterrains, les jus toxiques invisibles qui s’infiltrent dans les lacs et les rivières, tout cela donne à la contamination de l’environnement une dimension non seulement biologique mais aussi psychique. Même si la communauté Crie est absente des images, la qualité légendaire de leur espace collectif, désormais au bord du désastre, est évoquée dans Deep Weather par la voix off chuchotée : « La faune s’est retirée / les pièges sont vides / les anciens appellent les esprits / les jeunes chantent des chansons de rap / et le vent acide siffle / L’évolution n’est pas assez rapide. Mutez ! ». Le murmure, qui fait écho aux séquences aériennes filmées, active un espace-temps au-delà de la réalité physique et politique immédiate. Tu as tout à fait raison de dire qu’il s’agit pour moi d’un changement d’approche dans la mesure où la voix off invoque un récit de science-fiction.

Ursula Biemann & Paulo Tavares
Forest Law, 2014
Se déroulant à une époque de spectaculaire désordre géologique, chimique et hydrologique, la situation semblait exiger ce geste. La voix pénètre le bouillon chimique atmosphérique qui transporte les particules toxiques à travers le globe. Le murmure la rend aussi plus corporelle, il compense en quelque sorte l’absence des corps. De l’autre côté du globe, dans la deuxième partie de la vidéo, le cadre est rempli de personnes qui travaillent à mains nues, sans aucune machine, pour construire ces remblais de boue (au Bangladesh). Dans les deux zones géographiques, il s’agit d’une manipulation de la boue. Mais les deux géographies expriment des perspectives et des attitudes radicalement différentes à l’égard de la Terre. Au Canada, l’extraction agressive du pétrole lourd, l’imposante machinerie et le désir vertical d’extraction dans les profondeurs du temps ; au Bangladesh, l’engloutissement des communautés du delta, le travail manuel de millions de personnes et les espoirs de croissance économique submergés dans l’horizontalité d’un océan en crue. Alors que le Canada s’échine à viser l’accumulation de façon exhaustive, j’ai eu le sentiment qu’au Bangladesh, les gens investissent dans un avenir, aussi précaire soit-il. Pour moi, cette comparaison met en évidence que le changement climatique est aussi, et avant tout, une question de justice.
HG : Sur ces enjeux de justice, je souhaiterais évoquer Forest Law (2014) qui est une pièce emblématique et un moment charnière de ton travail sur des enjeux écologiques. Ce film a été tourné dans les forêts tropicales de l’Équateur, dans l’une des régions les plus riches de la planète en termes de biodiversité et de minéraux. Un territoire très convoité qui fait l’objet de fortes pressions de la part des compagnies pétrolières et d’une exploitation qui a entraîné une dégradation profonde des sols, des eaux, contaminés par les hydrocarbures et donc des conditions de vie des habitants. Tu as décidé de mettre en image ce territoire et de donner la parole à des chefs indigènes, juristes, scientifiques qui ont poursuivi en justice des compagnies pétrolières et minières pour faire reconnaître cette atteinte grave à la biodiversité et obtenir réparation et assainissement des sols. Notamment est évoqué le peuple Sarayaku qui, depuis 25 ans, est devenu une figure de la résistance. Leur système de défense était notamment fondé sur la dimension centrale d’une cosmologie de la « Forêt vivante » vitale pour la survie de la communauté. Peux-tu évoquer comment tu as abordé ce tournage et le travail de terrain que tu as mené ?
UB : Dans How Forests Think, Eduardo Kohn place l’anthropologie humaine dans un contexte sémiotique plus large de pensée de soi, qui inclut tous les êtres et leurs vies formelles, c’est-à-dire toute sémiose, mais aussi d’autres entités, tels que les esprits des ancêtres et les maîtres de la forêt, les protecteurs des écosystèmes, avec lesquels les chamans communiquent. Il a développé ces théories dans un village kitchwa situé près du territoire de Sarayaku où nous avons effectué notre travail de terrain en Amazonie. En élargissant le concept sémiotique, Kohn réussit à dépasser une anthropologie de l’humain, en reliant Donna Haraway à Viveiro de Castro. Cette théorie approfondie et merveilleusement créative a été utile pour Forest Law dans la mesure où elle a offert une hypothèse scientifique à certains des arguments les moins tangibles que les dirigeants indigènes ont présentés devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans leur lutte contre l’intrusion des compagnies pétrolières dans leurs territoires. José Gualinga, le chef du peuple Sarayaku à l’époque, parle de la forêt vivante comme de la forêt des êtres, un lieu où les micro- et macro-organismes communiquent entre eux et avec la communauté. Il est très facile de rejeter ces visions cosmologiques comme étant prémodernes ou simplement de l’ordre du mythe ; il est pourtant plus que nécessaire de commencer à les intégrer sérieusement dans notre pensée, qui a été dominée par des principes rationnels d’exclusion qui ont nui à la planète et à ses systèmes de vie. L’interprétation de Kohn de la forêt qui pense est une contribution extraordinaire. Pour Forest Law, nous nous sommes généralement concentrés sur les affaires juridiques liées aux forêts en Équateur, un pays qui se distingue comme un haut-lieu mondial pour ce type d’activisme environnemental. Sarayaku était l’un des principaux centres d’intérêt pour nous, mais il était difficile d’y accéder. Le conseil du village décide de tous les visiteurs qui peuvent entrer sur le territoire. Un contact personnel préalable avec l’activiste Franco Viteri nous a permis de nous rendre à Sarayaku à bord de ce minuscule avion à hélice et de l’interviewer, ainsi que José Gualinga, dont le témoignage s’est avéré crucial pour la vidéo et le livre.
HG : Forest Law met également en évidence l’importance du « savoir indigène » et du « scientifique indigène », figure de la réconciliation entre la connaissance ancestrale autochtone et le savoir occidental strictement rationnel. C’est une figure que l’on retrouve d’ailleurs dans Acoustic Ocean, film tourné dans les îles Lofoten, en Norvège, dans lequel tu mets en scène le personnage d’une jeune scientifique d’origine Sami (interprété par la compositrice, chanteuse et activiste écologique Sofia Jannok), un peuple autochtone semi-nomade qui évolue dans le Nord de la Norvège, de la Finlande, de la Suède et de la Russie. Le ou la « scientifique indigène » prend une place grandissante dans ton travail. Ces savoirs accumulés et transmis au fil des générations, inscrits dans une relation profonde aux territoires ont longtemps été méprisés et ignorés, reflets d’une histoire coloniale mais aussi d’une idéologie du progrès. Ils sont aujourd’hui progressivement reconsidérés au point que tu évoques dans un entretien : « The scientist plays a role that is equally important, and stands as signifier of, our own moment, as did the worker in the social transformations of the twentieth century, or the migrant since the onset of globalization ». (Le scientifique joue un rôle tout aussi important et significatif de notre époque, comme l’a fait le travailleur dans les transformations sociales du XXe siècle ou le migrant depuis le début de la mondialisation). Ce « scientifique indigène » serait donc pour toi la nouvelle figure paradigmatique de ce début de XXIe siècle ?

Ursula Biemann
Devenir University, Mocoa Meetings, 2018
Tournage dans la forêt
UB : Pour les artistes, le défi consiste à faire face au fait que, d’une part, les sciences modernes ont été critiquées à juste titre par les érudits postmodernes et postcoloniaux comme des instruments de pouvoir pouvant favoriser les mythes d’objectivité, de neutralité, etc. Mes vidéos documentent des scientifiques réels et fictifs qui accomplissent des actes scientifiques, utilisent des instruments scientifiques et aspirent à la rigueur scientifique, mais qui sont en même temps des travailleurs de terrain intégrés dans des écosystèmes complexes, travaillant à partir de positions incertaines et identifiés comme des acteurs politiques. Je m’intéresse au scientifique indigène parce que je le considère comme la figure radicale ultime qui a la capacité de fusionner ces contradictions. Avec l’essor de la pensée occidentale moderne, la relation de l’humain avec la nature a été déléguée aux sciences naturelles, ce qui conduit à considérer les indigènes comme des objets de recherche, mais jamais comme des sujets actifs pouvant entrer dans la sphère sociopolitique. Par conséquent, le fait de présenter l’indigène non seulement comme un sujet politique possédant une voix et un territoire, mais aussi, ce qui est plus scandaleux, comme un scientifique producteur de connaissances, va au cœur du problème actuel où les revendications extractivistes, fondées sur la logique des droits de propriété, se heurtent à une conception très différente de la nature vécue par les indigènes du monde entier. Leur épistémologie et leur immense réservoir de connaissances doivent commencer à jouer un rôle plus central dans l’élaboration de nos relations entre l’humain et la terre. Rendre possible une évolution dans cette direction est ce à quoi je souhaite me consacrer désormais.
HG : J’aimerais évoquer un projet inédit, très ambitieux et extrêmement stimulant dans lequel tu t’es engagée en 2018, dans le prolongement de Forest Law, celui d’une Université indigène, conçue à l’invitation du Musée d’art contemporain de Bogota et des peuples Inga en Colombie. Ce projet sur le long terme est une façon très concrète de construire une possible voie d’avenir, de préserver des savoirs ancestraux et des modes de vie respectueux et protecteurs de leurs écosystèmes mais aussi de réconcilier deux savoirs jusqu’ici opposés : savoir empirique, situé, versus savoir occidental, abstrait. Une façon aussi de tenter de dépasser une histoire coloniale… Peux-tu nous exposer les grands enjeux de cette « Devenir University » et ton rôle dans cette aventure ?
UB : J’ai été la première surprise de me trouver à collaborer activement à la fondation de cette nouvelle université indigène dans la région amazonienne de la Colombie, tout juste sortie d’un conflit. L’idée m’a été présentée lors d’un voyage sur le terrain à Nariño et Putumayo en Amazonie, où j’ai eu de longs entretiens avec des chefs de tribus indigènes. J’y ai acquis la conviction que finalement, dans un tel contexte, il était plus judicieux de participer à la création d’une institution qui contribuera à faciliter les sciences indigènes dans les années à venir que de produire une vidéo de plus à propos des pressions exercées sur les territoires indigènes et leurs forêts vitales. La préservation des connaissances ancestrales sur les écologies spécifiques des forêts pluviales et des forêts tropicales humides ainsi que sur les hautes landes brumeuses des paramos est absolument vitale pour la subsistance des forêts et des communautés qui les habitent. La diversité épistémologique et biologique de ces forêts est tout aussi nécessaire à leur survie, car ensemble, elles forment une entité bioculturelle. C’est l’un des fondements de cette nouvelle université.
Le projet est ancré dans la décolonisation de l’éducation et la justice environnementale, et représente un effort collectif rassemblant les communautés indigènes de la région avec des partenaires universitaires à Bogota et dans le monde entier. Mon intérêt à long terme pour le « producteur de connaissances » indigène trouve ici un terrain fertile pour des essais in vivo. Ce n’est pas exactement un petit projet, car une fois à plein régime dans quelques années, l’université devrait accueillir jusqu’à 400 étudiants. La faculté comprendra des experts autochtones ainsi que du personnel académique, offrant des expériences de départ fondées sur la pratique. De même, nous n’envisageons pas une architecture de campus compacte mais une série de sites et de points nodaux sur le territoire liés à la meilleure connaissance des rivières, aux jardins d’expérimentation, à la langue, à la connaissance des plantes médicinales, aux épistémologies forestières. L’ensemble du programme mettra l’accent sur les sciences de l’environnement, l’agroécologie et les façons d’interagir avec la forêt vivante. Située à côté d’un grand parc national non surveillé, l’université pourrait constituer une excellente plateforme pour les étudiants et les chercheurs internationaux de haut niveau.
En collaboration avec l’équipe éducative Inga et avec le soutien d’une équipe interdisciplinaire colombienne, nous sommes en train d’élaborer un projet détaillé. L’année dernière, j’ai organisé sur place un événement de lancement dévoilant la nature et l’objectif de cette nouvelle institution. Et je suis actuellement en train de construire une plateforme audiovisuelle en ligne baptisée « Devenir Universidad » qui documente l’étonnant processus d’un territoire indigène se transformant en Université. Dix-huit mois après le début du projet, j’ai compris quel pourrait être mon rôle dans ce processus, hormis l’établissement de partenariats. J’ai décidé que je pouvais apporter mon soutien en donnant une impulsion esthétique et conceptuelle à l’initiative menée par les indigènes et en traduisant les questions et les concepts de communication bioculturelle et multiepistemique par le biais de publications, d’expositions, de productions vidéo et d’une forte présence en ligne. En d’autres termes, j’ai trouvé ma place dans l’accompagnement esthétique du projet.

Ursula Biemann
Subatlantic, 2015
HG : Sur ces questions des savoirs situés ou académiques, je perçois dans ton œuvre une manière très singulière de convoquer des ressources scientifiques et de les hybrider avec de la fiction et même science-fiction pour partager avec un large public des enjeux intellectuels contemporains. Cette dimension fictionnelle s’ancre ainsi dans un ensemble de références très précises, dans une actualité de la recherche scientifique, anthropologique qui vient nourrir et ouvrir des perspectives. Je pense notamment à la vidéo Subatlantic dans laquelle le personnage d’une scientifique raconte la disparition des glaciers et leur conséquence : la libération de micro-organismes jusqu’ici emprisonnés, qui mêlent leur ADN archaïque aux écosystèmes d’aujourd’hui. À partir d’observations et interrogations scientifiques actuelles, tu spécules, par la voix de ton personnage, sur la possible apparition de nouvelles espèces et ces dynamiques invisibles à nos yeux, potentiellement génératrices de nouvelles interactions. Tu évoques également un rapport au temps élargi, la narratrice faisant référence à des périodes qui excèdent largement une vie humaine. Ce recours à la fiction m’évoque la position d’Isabelle Stengers qui défend depuis longtemps l’importance du récit, de la stimulation de l’imaginaire pour partager et rendre intelligible un savoir scientifique, et l’importance de la science-fiction pour envisager des possibles. Considères-tu également que le territoire de l’imaginaire et l’invention de récits offrent de possibles voies aujourd’hui pour envisager de nouvelles relations au monde – et est-ce une des sources de ton passage à la fiction ? Peux-tu également évoquer comment s’est opéré ce glissement vers la fiction ? Et enfin, comment injectes-tu ces contenus scientifiques qui sont esquissés, suggérés par des biais poétiques et visuels ? Est-ce l’état des recherches qui nourrit des fictions ou as-tu des enjeux de fiction que tu relies à une actualité de la recherche ?
UB : Lorsque l’on aborde l’infime dimension des microbes de l’eau ou l’ampleur écrasante d’un climat en surchauffe, le problème que l’on rencontre à l’évidence dans la production esthétique est que nombre de ces occurrences se déroulent dans des domaines invisibles à l’œil humain. J’ai donc imaginé qu’une pratique artistique post-humaine devait se dérouler simultanément à de nombreuses échelles. Pour en saisir les dimensions subtiles, j’ai dû recourir à des récits semi-fictionnels qui peuvent aider à étendre notre sensorium limité et nos schémas de pensée rationnels en introduisant une intelligence spéculative. Ainsi, les fictions des vidéos explorant les altérations de la composition chimique de la Terre, de l’atmosphère et des océans, expérimentent toutes des récits poétiques et des formes de science-fiction. Ce n’est certainement pas une coïncidence si les personnages fictifs que je crée sont des femmes qui se développent à travers les millénaires, qui ont des pouvoirs surnaturels et qui communiquent avec le vent et toutes les espèces. La colonisation des autres – qu’il s’agisse de femmes, de peuples indigènes ou d’êtres naturels – découle d’une seule et même logique. C’est pourquoi la réponse et la création d’alternatives visionnaires émergent également de cette même position.
L’imagination est évidemment un processus vital pour le monde et donc pour forger différents types de relations avec la nature, en plus de celles de possession et d’extraction. Les personnages fictifs de ces œuvres sont porteurs de savoir, ils transmettent des connaissances scientifiques qui sont facilement accessibles. Mais cela ne s’arrête pas à la réalité qui est tangible et mesurable. Leurs connaissances englobent également les pensées, les émotions, les appréhensions et les processus psychiques qui se fondent dans le paysage, la mer et les paysages glacés du Groenland. Le langage poétique que je crée est destiné à transporter le spectateur dans ces autres dimensions, en insérant dans le champ de l’information scientifique des moments de rupture avec la logique rationnelle. Créer ces ruptures me procure de grands plaisirs, je dois l’admettre. Mais je me délecte aussi des découvertes de faits scientifiques obscurs qui donnent du poids à l’incertitude de nos conditions de vie planétaires, comme dans le cas que tu as mentionné, du microorganisme vivant qui a survécu 400 000 ans dans la glace et qui entre progressivement dans le bain génétique du monde dans lequel nous vivons. La science n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, mais elle ne suffit pas à expliquer les données qu’elle-même produit. Les images et les récits doivent atteindre un imaginaire collectif, il doit aller plus loin que l’esprit rationnel. C’est pourquoi je cherche à créer des paysages qui incluent les dimensions psychiques et non temporelles.
HG : J’ai envie de partager avec toi une phrase de l’auteure de science-fiction, Ursula K. Le Guin :
« Nous sommes plusieurs à penser, depuis notre coin d’avoine sauvage, au milieu du maïs extra-terrestre, que, plutôt que de renoncer à raconter des histoires, nous ferions mieux de commencer à en raconter une autre, une histoire que les gens pourront peut-être poursuivre lorsque l’ancienne se sera achevée. Peut-être. Le problème, c’est que nous avons tous laissé nos êtres devenir des éléments de l’histoire-qui-tue, et que nous pourrions bien nous éteindre avec elle. C’est donc avec un certain sentiment d’urgence que je cherche la nature, le sujet et les mots de l’autre histoire, celle qui jamais ne fut dite, l’histoire-vivante. »1 Cette dimension est très frappante aussi dans ton travail, que tu ne circonscris pas à un constat critique de l’état du monde. Dans chaque vidéo, tu entrouvres des visions du futur, et tu partages des modes alternatifs d’habiter le monde, des « mondes émergents inédits et plus prometteurs », comme l’évoque l’anthropologue Eduardo Kohn : la cosmovision de peuples indigènes ; la communication inter-espèces et une éthique des relations avec d’autres espèces ; le soin et la réparation etc. Te reconnais-tu dans cette recherche de « l’histoire-vivante » face à « l’histoire qui tue » ? Et peux-tu évoquer cette position d’ouverture à d’autres visions qui offre un vrai changement de perspective et un contrepoint au discours de l’Anthropocène ? Ce discours qui nous enferme dans la sidération et le constat de la noirceur depuis le début des années 2000 et particulièrement depuis 2012, date d’un grand congrès de géologie débattant de la pertinence ou non de cette ère nouvelle.
UB : L’Anthropocène en tant que concept était important dans la mesure où il nous a arrachés au cadre historique à court terme et nous a propulsés dans des échelles de temps planétaires. J’ai pu littéralement ressentir à quel point cette idée a ouvert une nouvelle façon de percevoir notre place dans le monde. Sur une note plus positive, l’Anthropocène – en tant que dispositif narratif et esthétique – a facilité l’émergence de nouveaux types d’histoires, des histoires importantes qui amènent les arts, les sciences humaines et les sciences naturelles à se confronter de manière plus aiguë. Mais d’une certaine manière, le discours s’est enlisé trop vite soit dans la glorification de l’immense impact des humains sur la Terre grâce à leur ingéniosité technologique, soit dans une critique sévère. Mais dans un cas comme dans l’autre, cela ne nous aide pas vraiment à imaginer une autre façon d’être dans le monde. On ne peut pas critiquer et créer en même temps. Mais cultiver une vision plus douce de l’engagement dans le monde naturel est précisément ce dont nous avons le plus besoin maintenant. Il n’est pas surprenant que ceux qui pratiquent ce genre de vision cosmique – les peuples indigènes – soient ceux qui subissent la plus grande pression. L’économie extractive, l’industrie alimentaire, le système juridique, “l’histoire-qui-tue”, sont inhérents au système, ils imprègnent tous les domaines de notre société. S’engager dans des « histoires de vie » pourrait simplement consister dans le choix conscient de ne propager que des idées durables sur la vie qui inspirent un traitement éthique de tous les êtres vivants. Mais pour les écrivains et les artistes visuels, ce terrain a toujours été le terrain d’une imagination des plus vives.

Ursula Biemann
Acoustic Ocean, 2018
Vue exposition « Ursula Biemann. Savoirs indigènes_Fictions cosmologiques », MAMAC, Nice, 2020, image Cécila Conan
HG : Pour revenir à Acoustic Ocean, la scientifique Sami tente de capter les sons émis par les créatures des profondeurs sous-marines et d’entrer en communication avec elles. Le film introduit l’idée – très ancrée dans les cultures indigènes – d’une continuité de relations avec toutes les formes du vivant. Un parallèle est fait d’ailleurs entre la fragilisation du mode de vie des Samis, des rennes avec lesquels ils vivent et de leur écosystème et la grande vulnérabilité des créatures sous-marines affectées par toutes nos formes de pollutions (acidification des océans, émissions de sons, extraction sous-marine). Pour reprendre l’expression de Donna Haraway, tu suggères dans ton film un nécessaire « Devenir avec ». Dans ses écrits, on retrouve beaucoup l’idée que les scénarios de notre futur ne seront possibles que s’ils s’envisagent collectivement et dans une alliance inter-espèces entre l’humain et le non-humain. Tu explores dans ton travail cette vision et cet appel à un glissement d’une perception anthropocentrique vers une appréhension biocentrique du monde, vers une forme de conscience que nous faisons partie d’un réseau d’interactions avec d’autres formes de vie. Peux-tu évoquer ces enjeux ? Envisages-tu de les approfondir dans de prochains films ?
UB : Artistes, universitaires, militants, nous poussons tous maintenant dans cette direction. C’est la force d’écriture et l’incarnation d’un posthumanisme. Donna Haraway, comme toujours, a été une pionnière dans le démantèlement de l’humain en tant que sujet autonome pour le reconfigurer en tant qu’être qui forme des entités multiples et changeantes avec d’autres communautés vivantes et des environnements, tant naturels que machiniques. La plongeuse sami que l’on voit dans Acoustic Ocean est une incarnation vivante de cette idée. Elle fusionne avec l’environnement et, grâce à ses techniques de détection, révèle une mer pleine d’intelligence. Elle est à la fois une femme indigène portant un cache-col traditionnel en fourrure de renne et une scientifique dotée d’un équipement technique de plongée en haute mer. La proposition de Haraway est un moteur important pour tous ces travaux, tout comme le féminisme posthumaniste d’Astrida Neimanis dans Bodies of Water l’est spécifiquement pour Acoustic Ocean.
Mes vidéos insistent généralement sur l’intensification de la communication inter-espèces car elle place la vie au centre de ce qui constitue la réalité. C’est ce que l’objectif biocentrique signifie en fin de compte. Les artistes peuvent contribuer à ce changement de perspective en expérimentant un large éventail de formes narratives et esthétiques qui incarnent une écologie politique plus égalitaire et des relations inter-espèces plus horizontales. Mais la focalisation thématique ne se joue pas seulement au niveau du contenu, elle implique également un changement dans la façon dont je conçois mon rôle d’artiste. Les personnages imaginaires que j’invente interagissent avec les créatures de la terre, des forêts et des océans grâce aux technologies de détection. Ces interprètes de science-fiction incarnent une attitude sensible d’écoute, d’attention, de connaissance plutôt que de commentaire, d’appropriation ou d’exploitation. Ce n’est là qu’une des façons dont un artiste vidéo peut inspirer un traitement plus éthique de tous les êtres vivants.
La recherche scientifique se concentre principalement sur ce qui peut être perçu avec nos sens, si nécessaire, en dépassant nos limites sensorielles à l’aide d’instruments technologiques. Mais les humains et, en réalité, d’autres êtres, diffusent constamment des émotions, des pensées et des champs psychiques comme expression et extension de leur moi, atteignant des domaines immatériels. Mes recherches actuelles sur l’intelligence de la nature visent à mieux comprendre ces interrelations en s’appuyant sur des formes de connaissance à la fois scientifiques et chamaniques. Pour les peuples indigènes de l’Amazonie, une force vitale et une énergie spirituelle imprègnent tout ce qui existe, qu’il s’agisse d’entités visibles ou invisibles, les dotant d’une conscience et d’un sens. Il existe une intelligence innée dans la nature jusqu’au niveau moléculaire. Dans la science occidentale, tout semble indiquer une prolifération de pratiques d’objectivation par rapport à la nature, en particulier en Colombie, mon lieu de recherche actuel et véritable point chaud mondial de la bioprospection. Là-bas, la forêt est démantelée en petites données génétiques exploitables permettant une version particulièrement rapace du colonialisme scientifique. Dans la recherche de moyens pour ouvrir un dialogue inter-épistémique, mes recherches se concentrent sur les approches et les découvertes passionnantes qu’offrent actuellement des domaines plus porteurs de vie tels que la neurobiologie végétale, l’anthropologie des sciences, l’ethnobotanique et les philosophies qui s’intéressent à la vie des plantes. Pour ce nouveau projet vidéo, je devrais filmer dans les territoires indigènes de la forêt tropicale colombienne et j’espère pouvoir réaliser ce voyage l’année prochaine.
Entretien mené en septembre 2020, dans le cadre de l’exposition « Ursula Biemann. Savoirs indigènes_Fictions cosmologiques », MAMAC. Site de l’artiste : https://www.geobodies.org
Traduction : Stéphane Corcoral pour la version française et Angela Kent pour la version anglaise
Couverture : Ursula Biemann, Acoustic Ocean, 2018
1.Ursula K Le Guin, La Théorie de la Fiction-Panier, 1986.